Femme de culture et de talent, Delphine Schwartzbrod signe un premier ouvrage saisissant sur la quête de liberté d’une femme française aux XXème et XXIème siècles.
Camille Sorelle fait partie de ces inoubliables héroïnes de romans dont la trajectoire nous émeut et nous bouleverse intensément. Inappréciée par sa parentèle malgré ses exploits scolaires et professionnels une fois devenue adulte, cette femme sera longtemps mue par la volonté de fuir. À la fois son environnement de naissance, mais aussi un mari auquel elle s’est unie pour contenter les siens. Roman d’émancipation d’une femme contemporaine, Les Blessures vagabondes est également un très bel hommage à la littérature ainsi qu’à la psychanalyse : deux pratiques dont l’héroïne s’est accoutumée pour alléger ses maux et nous dépeindre avec discernement la dualité de la bourgeoisie provinciale catholique dont elle est issue. Entretien avec Delphine Schwartzbrod.
Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?
Delphine Schwartzbrod : Je suis née à Grenoble il y a 60 ans, où j’ai passé une partie de ma jeunesse, appris à lire et à écrire, à nager et à skier. Tous ces apprentissages, comme aller beaucoup au cinéma et à la Maison de la Culture, m’ont aidé à vivre. Mes études littéraires et en Sciences politiques ont d’abord été ancrées dans cette ville, au pied des montagnes que les autres étudiants et moi rejoignions à peine les cours terminés, puis je les ai poursuivies en Droit à Paris, où je vis toujours.
Mon parcours professionnel a eu pour fil rouge le développement des ressources humaines, sous différentes formes et dans plusieurs secteurs d’activité, mais avec toujours le même objectif : favoriser, autant que possible, le déploiement des compétences dans l’intérêt du salarié, du candidat à un emploi, de l’étudiant en stage, et donc de ceux qui les recrutent et les forment. J’occupe actuellement la fonction de DRH au Palais de Tokyo.
J’apprécie de pouvoir effacer des phrases, déplacer des mots comme déplacer les jetons de lettres au scrabble, sauter des lignes ou transformer une description en dialogue et voir immédiatement l’effet produit sur l’écran.
Delphine Schwartzbrod
Comment écrivez-vous ?
Delphine Schwartzbrod : Quand les émotions me débordent, quand je n’arrive pas à me faire comprendre, quand j’ai envie de partager une admiration, quand je veux garder la trace d’une sensation complexe ou riche, je prends depuis toujours ce qui me tombe sous la main pour écrire. Je suis ainsi passée du cahier d’écolière au journal intime de l’adolescente, des feuilles volantes A4 manuscrites à celles tapées à la machine puis rangées dans des chemises, jusqu’au jour où l’ordinateur est apparu.
Sur quel support écrivez-vous ?
Delphine Schwartzbrod : Sur l’ordinateur justement, mais je ne me rappelle pas depuis quand. J’aime cette façon de pouvoir aller en avant et en arrière sur l’écran comme dans ses pensées (malheureusement pas comme dans la vie). J’apprécie de pouvoir effacer des phrases, déplacer des mots comme déplacer les jetons de lettres au scrabble, sauter des lignes ou transformer une description en dialogue et voir immédiatement l’effet produit sur l’écran. L’ordinateur présente aussi l’avantage de pouvoir vérifier la répétition d’un mot, la bonne orthographe ou syntaxe. En revanche, je ne sais pas faire de relecture à l’écran, je suis obligée d’imprimer, de toucher le papier. Il faut que mes yeux croisent autre chose qu’une machine.
Avez-vous un rituel ?
Delphine Schwartzbrod : En général non, car mes textes sont spontanés, inachevés, sauf s’il s’agit d’un travail universitaire ou professionnel que j’ai besoin de réaliser à un bureau. Mais pour le manuscrit des Blessures vagabondes, avant de me remettre face à l’écran une partie de la journée (en général le week-end ou pendant les vacances, et dans le silence), j’ai eu envie d’écouter des chansons populaires, de danser toute seule sur des airs familiers, de regarder les bandes-annonces de films aimés, ou de scruter des vieilles photos de famille, comme pour m’imprégner de l’époque où se situe la vie de Camille Sorelle, l’héroïne.
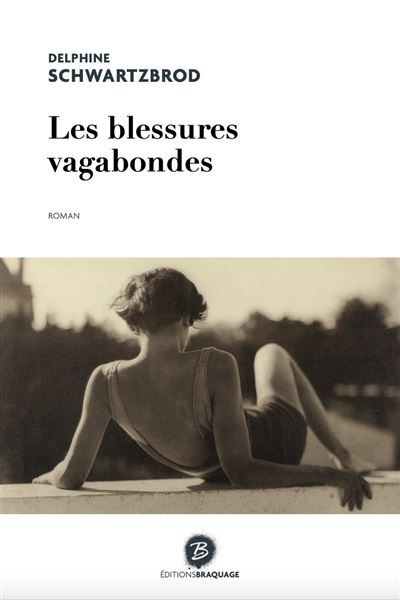
Procédez-vous à de la documentation ? Si oui, de quel ordre est-elle ?
Delphine Schwartzbrod : Pour écrire ce livre, je me suis replongée dans les questions d’actualité qui préoccupent le milieu où Camille Sorelle grandit (Mai 68, le premier Planning familial ou le « Manifeste des 343 salopes » en Une du Nouvel Obs, les Maisons de la Culture, les utopies urbanistes comme celle de la Villeneuve…etc). J’ai visionné des émissions comme les Dossiers de l’Ecran, Monsieur Cinéma ou Apostrophes qui ont rendu accessibles à Camille des idées, des films, des écrivains…bien avant qu’elle ne les découvre à l’occasion de ses études.
Vous avez récemment publié aux Éditions Braquage, Les Blessures Vagabondes, un livre poignant qui retrace la quête de liberté d’une femme française aux XXème et XXIème siècles. Quelle est la genèse de ce texte ?
Delphine Schwartzbrod : Il est né à la suite d’un atelier d’écriture que j’ai suivi avec bonheur et au cours duquel j’ai écrit, sans en avoir l’intention initiale, plusieurs « morceaux de vie » d’un personnage féminin qui s’est dessiné petit à petit. Un jour, je me suis dit que mis bout à bout, ces textes pouvaient retracer l’histoire singulière d’une héroïne de roman. J’ai été alors confrontée à un choix. Ou bien je comblais ce qui manquait entre les textes, pour mieux dévoiler l’identité de cette femme nommée Camille Sorelle, et en faire un objet homogène. Ou bien je suivais une autre voie : partir de ces textes et raconter comment Camille Sorelle les avait rédigés, donc relater aussi ce qui se passe dans l’atelier d’écriture. C’est ce procédé que j’ai retenu. Il m’a permis de faire rejouer à Camille, avec les membres de l’atelier, certaines scènes familiales (la difficulté à trouver sa place, à prendre la parole) et de parler aussi du travail d’écriture en lui-même, qui m’a toujours intéressée (le pouvoir des mots, des phrases, des livres, des écrivains, leur camaraderie quand on est malheureux).
Indésirée bien avant sa naissance, cette femme ne parviendra jamais à se faire aimer réellement de ses parents, malgré ses exploits. Comment expliquez-vous cela ?
Delphine Schwartzbrod : Je ne me l’explique pas totalement, un mystère demeure. Peut-être est-ce aux lecteurs de le lever. Pourquoi Camille n’est-elle pas aimée alors que ses deux sœurs le sont ? Si son arrivée « tombait mal », pourquoi cette grossesse a-t-elle été gardée par sa mère alors que d’autres non ? Une raison est bien suggérée au début du livre : au moment où sa mère tombe enceinte, alors qu’elle et son mari étudiant ont déjà une petite fille, la guerre d’Algérie fait rage. Or les pères de deux enfants en étaient exemptés. Le caractère fonctionnel de sa naissance a-t-il empêché ses parents d’aimer Camille ? N’est-ce pas plutôt parce qu’elle avait une sensibilité à vif, contrastant trop avec son milieu, ce qui aurait provoqué un rejet violent ?
Le travail d’analyse comme le travail d’écriture est une quête de soi, de la liberté d’être soi.
Delphine Schwartzbrod
Les Blessures Vagabondes semble ouvertement buñuelien en raison du portrait que la narratrice offre à la fois de la bourgeoisie provinciale et du clergé…
Delphine Schwartzbrod : Une certaine bourgeoisie catholique de province est le milieu social auquel j’appartiens et dans lequel j’ai grandi. J’ai donc eu l’occasion d’observer de près ce milieu, dans ma famille ou celle de mes amis, dans les paroisses où j’ai passé beaucoup de temps parce que je m’y sentais à l’abri, ou dans les rallyes que j’ai fréquentés clandestinement parce que j’aimais danser et que les garçons y étaient beaux. Le grand écart entre les valeurs prônées (par exemple le dimanche à la messe) et les vies telles qu’elles se déroulaient, m’a toujours perturbée. Les ambiguïtés ou maladresses dont pouvaient faire preuve certains prêtres encore plus. Pour autant, une partie de ce milieu pouvait également avoir une ouverture culturelle et politique que les enfants avaient les moyens d’utiliser ou de transformer par la suite, en quittant leur ville de naissance et en côtoyant d’autres milieux, comme l’a fait Camille Sorelle. Ce creuset m’est apparu intéressant.
Le livre est également buñuelien parce qu’il montre un sujet en train de se penser, que ce soit à travers les séances chez la psychanalyse ou les ateliers d’écriture…
Delphine Schwartzbrod : Je n’y avais pas pensé mais le livre a, en effet, quelque chose de buñuelien. J’ai eu la chance moi-même de faire une analyse avec une femme formidable, brutale mais d’une grande acuité et justesse dans ses paroles, comme je l’ai compris plus tard. Il m’a semblé que le lecteur pouvait avoir une clé supplémentaire de compréhension de l’héroïne, grâce à des extraits de ses séances allongée sur le divan. Juxtaposées aux séances « assise » de l’atelier d’écriture, elles donnent la possibilité de résoudre une partie de « l’énigme Camille Sorelle ». Le travail d’analyse comme le travail d’écriture est une quête de soi, de la liberté d’être soi.
L’écriture a-t-elle une vertu cathartique ?
Delphine Schwartzbrod : Oui, j’en suis sûre, regardez comme les ateliers d’écriture destinés à des populations fragiles (en prison, dans les maisons de quartiers, les foyers sociaux, les hôpitaux) sont des fenêtres ouvertes. Comme dit l’écrivain René Frégni qui anime un Atelier aux Baumettes à Marseille : « Un papier et un crayon sont plus efficaces qu’une scie pour détruire les barreaux d’une cellule ».
Mais, comme le souligne Camille Sorelle à la fin du roman, je ne crois pas que l’écriture « guérisse ». Au mieux elle allège. Me concernant, elle m’a toujours permis de me lester des colères, des humiliations, des idées noires mais les troubles sont toujours là. Je vis moins mal avec, c’est tout, j’ai identifié l’ennemi !
Lire des romans contemporains de femmes avec lesquelles je me sentais alliée ou d’hommes qui osaient dire leur chagrin ou leurs peurs, me donnait du courage mais pas la légitimité d’écrire. Jusqu’au jour où j’ai poussé la porte d’un atelier d’écriture.
Delphine Schwartzbrod
Qu’est-ce qui vous a décidé de vous lancer dans l’écriture ?
Delphine Schwartzbrod : Il y a déjà longtemps que je voulais raconter le roman d’une femme ayant des points communs avec mon histoire, sans doute depuis que j’avais lu en Hypokhâgne Le Journal d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et décidé d’aller vivre à Paris pour fouler les lieux qu’elle avait arpentés. Mais je ne me l’autorisais pas, je tournais autour (un mémoire universitaire sur L’Amour et la guerre, une introduction au rapport ministériel sur le Mécénat, des critiques de livres ou de films). Lire des romans contemporains de femmes avec lesquelles je me sentais alliée ou d’hommes qui osaient dire leur chagrin ou leurs peurs, me donnait du courage mais pas la légitimité d’écrire. Jusqu’au jour où j’ai poussé la porte d’un atelier d’écriture. A partir de là, il a seulement fallu voler du temps à ma vie pour m’y mettre et avancer.
Quels sont les textes et auteurs qui vous ont permis de vous construire intellectuellement et humainement ?
Delphine Schwartzbrod : Les études que j’ai choisies m’ont permis de lire tous les classiques avec un plaisir intense. J’ai alterné très tôt avec des romans contemporains sur des destins de femmes, qu’il s’agisse de relations mère-fille, de place à conquérir, d’appartenance à une classe sociale (les livres que ma mère achetait, Françoise Sagan, Benoite Groult, ou Raphaëlle Billetdoux ; ceux que j’ai découvert moi-même pour accompagner ma vie, Marguerite Duras, Annie Ernaux, Alice Ferney, Catherine Cusset, Nancy Huston, Lola Lafon). Certains destins d’hommes m’ont également aidée à me construire (Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes a été mon premier éblouissement, « Quoi ! Un intellectuel adulte pouvait ressentir ce qu’une adolescente vivait au quotidien ! » mais il y eut aussi Fritz Zorn, JB Pontalis, Jérôme Garcin, Martin Winckler).
D’autres livres encore m’ont bouleversée, par la profondeur de leur réflexion sur la condition humaine, sur la manière de résister à la barbarie (Si c’est un homme de Primo Levi, bien sûr, mais aussi Vie et destin de Vassili Grossman, Histoire d’une vie d’Aharon Appelfeld, et plus récemment le Tabac Trezniec de Robert Seethaler).
Quelques livres sur les bonheurs ou les affres de la création m’ont également passionnée (la trilogie Moi je, Nous et Somme toute de Claude Roy, Histoire de l’Art d’Elie Faure qui va bien au-delà, ou En lisant en écrivant de Julien Gracq).
Enfin, j’ai découvert depuis peu avec un grand intérêt certains livres engagés comme Nos enfants après eux de Nicolas Mathieu, ou L’art de perdre d’Alice Zeniter. La littérature aide ici à mieux comprendre comment la politique a failli, a laissé de côté ceux qu’elle était aller chercher pour faire fonctionner les usines ou faire la guerre, qu’elle avait exploités pendant des années jusqu’au moment où elle n’en a plus eu besoin. La colonisation a continué de faire des dégâts irrémédiables et le capitalisme financier l’a emporté sur la nécessaire protection des plus faibles.
Il est abondamment question de cinéma dans le roman. Qu’est-ce que vous aimez dans le cinéma ?
Delphine Schwartzbrod : Qu’il m’emmène, m’emporte, me permette de tout oublier, me fasse rire, pleurer, sortir ce que je n’arrive pas à mettre en mots ou en vibrations, me donne la possibilité d’être quelqu’un d’autre pendant deux heures, de fredonner à jamais un air qui toujours me ramènera à son héros ou son héroïne (l’air des 400 coups quand Jean-Pierre Léaud arrive au bord de la mer, le concerto pour mandoline qui accompagne les progrès de L’enfant sauvage de François Truffaut, les mélodies d’Ennio Morricone dans Cinéma Paradiso, de Nino Rota chez Fellini… musiques indissociables d’images inoubliables).
J’ai beaucoup aimé certains films de la nouvelle vague, le néoréalisme italien, mais aussi les comédies sociales ou policières française des années 70 qui m’ont ancrée dans mon époque ou m’ont fait comprendre certains enjeux historiques majeurs.
Delphine Schwartzbrod
Quels sont les films et cinéastes que vous aimez ?
Delphine Schwartzbrod : En plus des films cités plus haut, j’ai beaucoup aimé certains films de la nouvelle vague, le néoréalisme italien, mais aussi les comédies sociales ou policières française des années 70 qui m’ont ancrée dans mon époque ou m’ont fait comprendre certains enjeux historiques majeurs (Costa Gavras). D’autres films étrangers m’ont permis de découvrir des pays inconnus (comme l’Iran d’Abbas Kiarostami ou la Turquie de Yılmaz Güney).
Si je devais ne citer seulement que quelques films, je dirais Kes de Ken Loach, Cria Cuervos de Carlos Saura, la trilogie Welcome in Vienna d’Axel Corti, La leçon de piano de Jane Campion, Rocco et ses frères de Visconti, 1900 de Bernardo Bertolucci mais vous voyez… je ne parviens pas à m’arrêter.
Et comme réalisateurs, dont j’aime quasiment tous les films, Woody Allen, Nanni Moretti, James Gray et Philippe Lioret.
Plusieurs des cinéastes et écrivains que vous citez ont un rapport spécifique aux langues, notamment française. Quel est le vôtre ?
Delphine Schwartzbrod : A l’oral, la langue me joue parfois des tours, mon histoire familiale vient sans doute se nicher là. C’est pourquoi j’ai choisi en exergue de mon livre l’extrait du discours de Patrick Modiano, à la remise de son Prix Nobel, sur sa difficulté à prendre la parole. Il m’arrive d’employer un mot pour un autre, de trébucher. A l’écrit, je me rattrape, je retrouve un équilibre, le temps m’est donné, la sanction n’est pas immédiate, je peux me corriger.
Je ne suis pas la plus douée pour les langues étrangères mais j’aime la littérature étrangère traduite.
Comment travaillez-vous la langue dans laquelle vous écrivez ?
Delphine Schwartzbrod : J’écris d’abord comme ça me vient, à l’instinct, presque comme en écriture automatique, sans construire véritablement une pensée et sans plan. C’est donc toujours un peu décousu et trop long ; il y a beaucoup de propositions relatives, j’abuse des auxiliaires être et avoir. Dans un second temps, je construis, je coupe, je réécris, il me faut toujours réduire ou remplacer des phrases entières, et enfin je polis.
Comme certains écrivains l’ont si bien formulé, la littérature est l’école de la complexité humaine et de la nuance.
Delphine Schwartzbrod
Lisez-vous de la bande dessinée ?
Delphine Schwartzbrod : La lecture hebdomadaire de Pif Gadget pendant plusieurs années m’a initiée à la bande dessinée et elle ne m’a plus quittée depuis, parce qu’elle me distrait autant qu’elle me nourrit, me fait rêver et m’instruit. Le magazine pour enfants alternait des planches d’une ou deux pages uniques, la plupart avec des animaux (comme le chien Gai Luron et son amie la coccinelle qui m’ont fait entrer dans l’univers de Gotlieb, que je retrouverai avec délices, adolescente, dans la « rubrique à brac » de Pilote et récemment à l’occasion de son exposition au Musée d’Art et d’histoire du judaïsme) et une succession d’épisodes d’histoires différentes. Il fallait patienter jusqu’à la semaine suivante pour connaitre la suite, ce qui augmentait le désir. J’attendais par exemple avec gourmandise la suite des aventures de Corto Maltese, d’Hugo Pratt, ce beau marin dont j’étais un peu amoureuse. Mais j’aimais aussi Docteur Justice qui me faisait découvrir l’OMS et l’engagement humanitaire ou Rahan « fils des âges farouches » qui m’a donné le goût de la préhistoire.
En parallèle, partout où ils étaient car mes parents n’en achetaient pas, chez mes cousins par exemple, dans les maisons de vacances où nous étions invités, aux stations-services qui les échangeaient contre des bons de pleins d’essence, ou encore à la Bibliothèque municipale où je passais beaucoup de temps, j’ai dévoré tous les Lucky Luke, Asterix et Tintin, mais aussi les Lili et les Aggie, que j’ai lus et relus sans jamais me lasser, comme des amis qu’on retrouve aux vacances et avec lesquels le lien se renoue immédiatement.
Teenager, mes parents étant lecteurs du Nouvel Observateur, j’ai été admirative des Frustrés de Claire Bretecher, sur lesquels je me précipitais dès que le magazine arrivait à la maison. Il me semblait si bien les connaître que je me demandais comment elle pouvait décrire des proches, peut-être comme les teenagers d’aujourd’hui ont réagi en découvrant l’héroïne des Cahiers d’Esther de Riad Sattouf dans le même hebdomadaire, qui maintenant s’appelle L’Obs. Quand je suis allée voir l’exposition de Claire Bretecher à la BPI du Centre Pompidou (mais aussi celles que la bibliothèque de Beaubourg a consacrées à l’œuvre de Riad Sattouf et de Catherine Meurisse dont je parlerai plus loin) j’ai été impressionnée par le fil rouge qu’on peut identifier pour chacun de ces artistes depuis leurs premiers croquis, par leur don d’observation, leur capacité à illustrer une situation ou des personnes avec une intelligence rare, tout en faisant de leur singularité un monde d’idées (sociologiques, géopolitiques, ou écologiques).
Lire aussi : Marcello Quintanilha, bédéiste sociologue
Et puis est arrivé le choc Maus d’Art Spiegelman, un « roman graphique » dit-on (ce qui est déjà une manière de répondre à la question suivante) qui m’a bouleversée, tant par le récit de la shoah que par le rapprochement d’un fils illustrateur vers son père, juif ashkénaze rescapé d’Auschwitz qui s’est enfermé dans le silence après avoir émigré aux Etats-Unis. Il contient tout ce qui me touche, l’Histoire, la névrose familiale qui se transmet officiellement, sournoisement, ou chaleureusement, les non-dits, mais aussi l’archéologie d’une recherche, comme plus tard Daniel Mendelsohn l’entreprendra avec Les Disparus, « roman littéraire » qui pour moi est pourtant du même niveau.
J’ai eu ensuite une longue période avec pour seules bandes dessinées, celles que je lisais aux enfants qui étaient dans ma vie (par exemple les inoubliables Tom-Tom et Nana de Bernadette Desprès, tellement drôles et créatifs, multipliant les bêtises dans le restaurant de leurs parents peuplé de personnages si pittoresque) et puis j’y suis revenue par des récits où l’intime se mêle à l’Histoire, à l’actualité ou à la religion : par Joann Sfar et le Chat du rabbin sur la mémoire yiddish, Quartier lointain de Jiro Taniguchi sur la quête du père mais aussi la série Perspépolis de Marjane Sartrapi, qui m’a autant marquée sur l’Iran que les Arabe du futur de Riad Sattouf sur la Syrie. Du même auteur, et sur un mode plus léger, j’ai aimé bien sûr Les Cahiers d’Esther que j’ai achetés à mes fils mais que je dévorais avant eux.
Peut-être en raison de mon métier où la question du travail est importante, comment on le vit, ou le perd, les Combats ordinaires de Manu Larcenet m’ont profondément marquée. Ils ont pour moi la puissance de la chanson Les Mains d’or de Bernard Lavilliers ou de Retour à Reims de Didier Eribon, sur la classe ouvrière et le chômage qui l’a frappée, la génération transfuge qui suit mais ne suit pas l’idéologie de ses parents. Et je réalise en vous le disant que c’est à nouveau une histoire de fils qui se rapproche de son père en essayant de le comprendre, tout en avançant lui-même dans sa propre vie de photographe indépendant, d’amoureux et de père à son tour.
En tant que femme, j’ai beaucoup souri aux albums de Florence Cestac (surtout Changement d’herbage réjouit les veaux) et de Pénélope Bagieu.
Lire aussi : Catel Muller, biographe de femmes exceptionnelles
Enfin, mon dernier éblouissement a été La Légèreté de Catherine Meurisse qui est le chemin d’une renaissance après le traumatisme de l’attentat de Charlie Hebdo auquel elle a échappé. La page où l’auteur se dessine en couleur après beaucoup de dessins en noir et blanc en haut d’une montagne disant : « moi ce qui m’a soudain paru le plus précieux après le 7 janvier, c’est l’amitié et la culture », ce à quoi un autre personnage répond « moi c’est la beauté », dialogue qui se conclut par : « c’est pareil » est un chef d’œuvre, aussi fort qu’un tableau. Dans le même esprit, l’album Dessiner encore de Coco, est également une réussite.
L’avez-vous remarqué ? Qu’il s’agisse de Claire Bretecher, Riad Sattouf, Art Spiegelman, Manu Larcenet ou Catherine Meurisse, ils mettent tous en scène à un moment ou à un autre de leur récit un personnage de psy qui les aide. J’aime aussi la Bande dessinée pour ça, sa capacité à rendre accessible une pratique parfois incomprise.
De ses débuts à aujourd’hui, le statut définitionnel de la bande dessinée n’a cessé d’évoluer. Si certains le considèrent comme un art appartenant au registre pictural, d’autres le rattachent à la littérature. Quel regard portez-vous sur ce débat ?
Delphine Schwartzbrod : Comme vous l’aurez compris avec mes réponses précédentes, la bande dessinée est selon moi à la croisée de différentes disciplines artistiques et sciences humaines, les arts plastiques ou visuels et la littérature mais aussi le récit historique et l’essai sociologique. Et de même que la beauté encore renouvelée des chansons de Serge Gainsbourg par exemple dans l’album « Symphonique » contredit sa certitude que la chanson est un « art mineur », comme il le disait, la bande dessinée n’est en tout cas pas un art mineur.
Un texte a-t-il besoin d’être écrit pour être considéré comme de la littérature ?
Delphine Schwartzbrod : Si la question peut s’entendre comme « Une chanson est-elle de la littérature ? » ma réponse est « non », même si les paroles ont été écrites avant d’être chantées. Pour autant, je ne pourrais pas vivre sans chansons, elles me font parfois l’effet d’un très joli court-métrage (Non je n‘ai rien oublié de Charles Aznavour ou La Rua Madureira de Nino Ferrer). Mais, comme certains écrivains l’ont si bien formulé, la littérature est l’école de la complexité humaine et de la nuance. Une chanson ne peut pas vraiment y prétendre, contrairement selon moi à certaines chroniques judiciaires (Pascale Robert Diard dans Le Monde) ou cinématographiques (Jacques Mandelbaum dans le même quotidien).
Les cris dans une manifestation ne sont pas davantage de la littérature mais ils sont importants.
Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?
Delphine Schwartzbrod : Il est en mode mineur. J’essaie de restituer ce que la mémoire a rangé dans un coin mais dont elle ne s’est jamais séparée, je tente de permettre aux lecteurs et lectrices de s’identifier pleinement à un personnage ou de l’accueillir, de reconnaitre des sensations dans celles que l’héroïne éprouve, même si ce n’est pas leur histoire. C’est un travail qui vise à susciter progressivement, page après page, une émotion, à faire naître une connivence, voire une familiarité. C’est une main tendue.
Et votre style ?
Delphine Schwartzbrod : Il est simple d’accès, il n’est pas flamboyant, ni épique. Le vent ne souffle pas mais il y a, j’espère, une légère brise, une « petite musique » comme disaient mes camarades d’atelier.
D’autres projets analogues ?
Delphine Schwartzbrod : J’aimerais continuer d’écrire, non pas sur la vie de Camille Sorelle (tome II), mais sur certains thèmes abordés dans le livre, comme la difficulté de ne pas être prisonnier de sa propre histoire. Je souhaiterais aussi traiter de personnages, laissés volontairement en retrait dans Les Blessures vagabondes comme Rachel et Jacob, ces deux amis pour la vie qui se sont rencontrés enfants à Ellis Island.
