Il émane toujours des écrits de Norbert Czarny une très grande tendresse lorsqu’il est question de sa parentèle ou de ses amis. Dans Les Valises, magnifique premier roman publié en 1989, Norbert Czarny part d’un événement attristant pour raconter amènement les trajectoires de ses grands-parents et à travers eux celles de beaucoup « d’errants et fugitifs » entre l’Europe et l’Orient. Entretien avec Norbert Czarny.
Comment avez-vous découvert la littérature ?
Norbert Czarny : Je dirai d’abord quand : tard. Tard en hypokhâgne. Jusque-là, je lisais beaucoup de livres d’Histoire sur la Révolution française et sur l’Empire, avec bien sûr Napoléon pour héros. Je lisais parfois de la littérature, mais c’était ponctuel et rapide, superficiel. J’appartiens à un milieu populaire dans lequel les livres étaient présents, certes, mais tournaient souvent autour du témoignage et de la Seconde Guerre mondiale. Nous sortions à peine de cette période, sur le plan familial j’entends. Je suis né en 1954, soit à peine dix ans après les faits. Et vous savez quel traumatisme ils représentent pour les miens. J’ai l’impression que la littérature aurait été de l’ordre du divertissement, de la superficialité. Nous n’avions donc pas de romans de Dumas, de Verne et a fortiori de Balzac, Stendhal et Flaubert. J’ai découvert ces romanciers sur le tard, voire le très tard, avec d’autant plus de plaisir. J’ai lu Le Comte de Monte-Cristo quand j’avais plus de quarante ans.
De la superficialité ? Milan Kundera dont vous avez été l’élève disait pourtant de la littérature qu’elle accompagne constamment et fidèlement l’homme dans la compréhension du monde et de l’histoire depuis le début des Temps Modernes…
Norbert Czarny : C’est parce qu’il croyait énormément aux pouvoirs de la littérature, même si celle-ci ne peut strictement rien dans ce monde. Elle ouvre des champs nouveaux, ce qui n’est pas rien. Mais face à l’ignorance, à l’oubli et à la marchandisation de toute chose, la littérature reste impuissante.
Ou alors elle peut juste sensibiliser les plus jeunes sur certaines choses. À l’adolescence, ma mère voulait d’ailleurs que je lise La Terre de Zola. Elle pensait que je comprendrais mieux le monde paysan. Lequel avait quand même changé, depuis 1855. J’ai lu l’essentiel des Rougon-Macquart, mais pas ce roman-là. J’aime beaucoup Au bonheur des dames, que la dernière année de ma carrière, j’ai enseigné en troisième, en lien avec des extraits des Années d’Annie Ernaux, et des Choses de Perec. L’Assommoir m’a aussi plu. C’est l’un des romans les plus noirs de Zola, qui n’a jamais réussi dans la gamme des roses. J’ai commencé de lire Une page d’amour, je crois et j’ai abandonné. Je préfère le Zola plus « dur », mettant en lumière le cynisme, l’arrivisme, la brutalité de son époque.
Qu’est-ce que vous aimez dans l’écriture et le projet littéraire de Zola ?
Norbert Czarny : Au risque de choquer, je dirais que son écriture est assez épaisse. Si je devais comparer avec de la cuisine, et pour rester dans sa région natale, cela me rappelle la bourride ou la bouillabaisse. Je préfère une cuisine plus légère, celle de Stendhal par exemple et bien sûr la popote flaubertienne. Mais Zola est généreux, il ne lésine jamais sur la métaphore, l’image ou la comparaison et son écriture emporte. Quant au projet, il est ambitieux et il mène à bien cet ensemble visant à présenter le Second Empire dans ses diverses dimensions. En ce moment, nous regardons une série italienne diffusée sur ARTE et intitulée 92, 93, 94. C’est bien sûr moins ample que Zola, mais sans lui, de telles séries sont impossibles…
Pour ce qui est de ses combats, bien évidemment, ils l’honorent. Il a pris de gros risques et même si les réseaux sociaux, qui sont au contraire des réseaux asociaux, n’existaient pas alors, il a subi la fureur de la populace menée par des démagogues, des extrémistes, des antisémites qui voulaient sa mort durant l’Affaire Dreyfus. Et qui peut-être l’ont provoquée. On ne sait pas si son asphyxie est accidentelle ou provoquée.
Pour le reste, c’est un homme de son temps, celui du colonialisme, d’un scientisme qui voyait dans les Noirs des êtres inférieurs, mais il ne s’est pas distingué par des propos racistes, à ma connaissance.


Les textes de Zola peuvent-ils encore dire quelque chose de nos sociétés ?
Norbert Czarny : Oui et non. Oui, parce qu’un classique n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire (formule de Calvino dans Pourquoi lire les classiques ?) et que Zola a décrit des mécanismes qui se sont simplement raffinés ou complexifiés. La Bourse n’a pas changé, la spéculation immobilière reste puissante etc.
Parmi les auteurs figurant dans votre panthéon littéraire se situent également Flaubert et Balzac. Qu’est-ce que vous aimez dans l’œuvre de ces auteurs ?
Norbert Czarny : À coup sûr, chez Balzac, le goût du récit, le plaisir de conter. Chez Flaubert, la beauté dans le moindre détail, pas forcément la beauté à travers la grâce, mais une beauté du laid, du médiocre, du sinistre, du bête. Flaubert est toujours notre contemporain. Son art du roman annonce les contemporains comme Kundera ou, dans des genres différents, Perec ou Annie Ernaux dont les œuvres consistent à observer, montrer, ne pas juger les plus humbles, donner sa chance à chacun. Mais aussi montrer la place que prend l’ennui dans nos sociétés. L’ennui existait depuis longtemps : il s’incarne en Emma Bovary et partant, en chacun de nous. Et puis il y a l’ironie. L’ironie différente à la fois du sarcasme et des ricanements de la foule. Le pessimisme de Flaubert, notamment dans L’Éducation sentimentale continue de me marquer, même si j’essaie de trouver les lueurs. C’est ma bêtise à moi, en somme.
Flaubert et Balzac ont-ils été d’autre apport dans votre parcours ? Vous ont-ils permis de vous construire ?
Norbert Czarny : Oui et non : je pense que j’étais attiré par la fiction. Surtout pas par les idées, les théories et encore moins les dogmes donc incapable de m’intéresser vraiment au monde comme il ne va pas. L’ironie de Flaubert, voire parfois de Balzac sont forcément des voies pour se construire. J’espère avoir hérité d’eux l’ironie, fondement selon moi de toute écriture. Et puis j’ai le sentiment d’avoir tout appris et compris en lisant L’Éducation sentimentale.
Qu’est-ce que vous aimez dans la fiction ?
Norbert Czarny : La fiction est une histoire inventée ou pas, mais mise en forme. J’aime qu’elle puisse brasser des idées sans que cela se voie, sans que cela pèse. C’est l’émotion qui domine. C’est cette même émotion que je recherche au cinéma ou dans un musée. J’ai envie d’être remué par un film ou un tableau. Je suis hélas insensible à la sculpture, sauf à celle de Giacometti. Ce que j’aime chez lui, c’est sa simplicité extrême, son austérité peut-être, et le fait qu’en quelques gestes, un chat, une femme ou un objet existent.

Sur la scène littéraire contemporaine, quels sont les héritiers de Flaubert et Balzac ?
Norbert Czarny : L’héritage de l’un n’est pas celui de l’autre. Il y a des « descendants » de Balzac, mais beaucoup ont cru que répéter son « réalisme » suffisait. Ils copient ou croient que la « recette » suffit : montrer le monde tel qu’il est. Mais tout se passe derrière. Ils oublient le visionnaire. Pour ce qui est de Flaubert, les choses sont plus simples et si je n’en retenais qu’un, ce serait Jean Echenoz.
Ce qui le lie à Flaubert, c’est le regard ironique sur la société, la capacité à montrer ce qui demeure et ce qui change, notamment dans la ville. J’ai lu Bristol, son nouveau roman à paraître, et j’y retrouve cela.
Chez Echenoz, il n’y a pas une phrase convenue. Tout est inventif, surprenant, et surtout, surtout, drôle. Rien ne reste inanimé : une chaise, des poissons dans un aquarium, un paquet de cartes à jouer, tout est personnifié. Les portraits sont à pleurer de rire, surtout quand le personnage masculin porte une moustache. J’ai numérisé des extraits pour me les garder de côté. Pour moi lire Echenoz est un élixir de bonheur. Je ris.
Comment développer l’attrait des élèves et étudiants pour ces différents textes souvent lus par obligation et non par plaisir ?
Norbert Czarny : Ayant pris ma retraite, je me sens désemparé par cette question. J’ai su et je ne sais plus. Au sens où la lecture et d’abord la capacité de concentration sont tellement affaiblies que je ne sais pas où nous allons. Je ne veux pas généraliser, ni tomber dans le lieu commun, dans l’opinion toute faite, mais je suis inquiet. Notre incapacité à considérer d’autres temps que le nôtre m’attriste. Or, quand vous lisez un roman de chevalerie ou un Balzac, vous devez accepter les codes d’une époque lointaine. Le présent semble tout envahir.
On peut se sentir proche d’écrivains ou d’écrivaines aux antipodes les uns des autres. Il faut juste avoir le sentiment que l’on est partie prenante de cette histoire.
Norbert Czarny
Lorsque vous étiez enseignant, comment transmettiez-vous le goût de la lecture, notamment d’œuvres littéraires, à vos élèves ?
Norbert Czarny : Je ne pouvais pas enseigner d’œuvres que je n’aimais pas ou ne comprenais pas. Oui, je sais, c’est gênant de le dire, mais je n’ai jamais compris Le Grand Meaulnes, je n’ai jamais bien vu l’intérêt du Petit Prince car je n’aime pas la « poésie » que je trouve très fabriquée de ce conte. Je préfère la cruauté de Roald Dahl, l’ironie de Queneau, celle de Calvino dans Marcovaldo ou la vraie poésie de certains contes de Perrault. J’adore La Petite marchande d’allumettes d’Andersen. Mais est-ce un conte ? Pour quelqu’un qui supporte mal Noël et le nouvel an, ce « conte » exprime tout : certains se gavent, d’autres rêvent.
Bref, j’avais besoin d’être très convaincu moi-même. Moyennant quoi, une promotion de 1re a lu Valery Larbaud et présenté Les poésies d’A.O. Barnabooth au baccalauréat ainsi que Memory Lane de Modiano. Mais aussi Britannicus de Racine et Le Misanthrope de Molière. Sans parler de certains extraits comme le portrait de la princesse d’Harcourt par Saint-Simon. La dame en question se promenait avec sa chaise percée. Je vous laisse imaginer. Mais on s’est régalé. Au collège, j’ai aimé mon cours sur Des souris et des hommes et ce roman de Steinbeck continue de me toucher. Sans parler des Misérables de Victor Hugo. Toucher, émouvoir sont les premières règles.
Les Misérables de Victor Hugo semble être une œuvre qui a eu un rôle marquant dans votre parcours. Qu’est-ce que vous aimez dans ce texte ?
Norbert Czarny : J’aime pleurer. Et donc l’épisode du petit Savoyard dont Valjean vole l’unique pièce de monnaie me bouleverse comme me bouleverse la mort digne et solitaire de Valjean. J’aime être en colère contre des personnages et je le suis contre l’ignoble Bamatabois, ce bourgeois infatué qui jette de la neige dans le dos nu de Fantine, alors qu’elle se prostitue et n’a plus rien, ni dents ni cheveux. Je suis encore indigné par Thénardier, qui échappe à son sort promis et devient marchand d’esclaves aux Etats-Unis. Bref, je marche à l’émotion et je suis servi. Sans parler de tout ce qui ne sert à rien : les longs chapitres sur les égouts, sur l’argot. Il va de soi que ça sert, je suis provocateur ! J’aime aussi les digressions de Hugo et sa capacité à faire image dans tous ses romans. C’est un visionnaire, un génie. En disant cela, je fais dans le lieu commun mais cela ne me gêne pas.

Quelle est votre définition personnelle de la littérature française ?
Norbert Czarny : C’est le fait de se sentir ancré, par ses lectures comme par sa (rare) pratique dans une tradition qui remonte très loin, sans doute au Moyen Age (mais je connais mal les œuvres de ce temps) et à une langue dans toute son amplitude. On peut se sentir proche d’écrivains ou d’écrivaines aux antipodes les uns des autres. Il faut juste avoir le sentiment que l’on est partie prenante de cette histoire. Les romans qui fleurissent en ce moment, sur des sujets « actuels » n’ont à mon avis pas cette idée de l’histoire.
Qu’est-ce qui fait la spécificité de la littérature française par rapport aux autres littératures du monde ?
Norbert Czarny : Je pense que cette littérature s’inscrit dans la langue et dans les paysages. Autrement dit être antillais, canadien, indien ou algérien et s’inscrire dans le paysage de sa terre, et l’écrire en français est faire partie de cette spécificité. Et pour le dire vite, ce n’est pas la même chose que parler le letton, le portugais ou le chinois dans les terres ainsi évoquées. C’est une autre expérience.
Outre les figures auctoriales susnommées, certains auteurs et autrices que vous aimez ont en commun d’ancrer leur œuvre dans un lieu ou un territoire : Joseph Winkler, Marie-Hélène Lafon, Maryline Desbiolles…
Norbert Czarny : Cela a sans doute à voir avec le fait qu’étant parisien, mais sans antécédent dans cette ville, je n’ai pas de véritable ancrage. J’admire donc des écrivains qui se tiennent en un lieu, qui lui donne toute son amplitude et qui savent rendre le lien arrachement/attachement que raconte Marie-Hélène Lafon. Même si elle a passé une grande partie de sa vie comme professeure à Paris, elle a son territoire dans le Cantal, c’est très circonscrit. Pour Winkler, comme c’était le cas pour Thomas Bernhard, le rapport avec le territoire est d’amour haine. Pour reprendre ou paraphraser un dialogue de François Truffaut dans La femme d’à côté, c’est : « ni avec toi ni sans toi ». Winkler joue sa vie là où il vit, à Kamering en Carinthie, une des régions que le nazisme continue d’imbiber.
Auteur de langue française, vous avez publié deux ouvrages, dont Les valises, un roman dans lequel vous dépeignez tendrement le portrait de « Mémé », votre grand-mère pittoresque avec laquelle vous entreteniez une belle relation. Quelle est la genèse de ce roman ?
Norbert Czarny : Tout a commencé avec la mort de cette grand-mère et le fait qu’elle était née sous l’Empire des Habsbourg finissant, dans les confins de la Pologne, désormais l’Ukraine. À cette époque, vers 1980, je lisais les écrivains d’Europe Centrale (Joseph Roth, Bruno Schulz, Kusniewicz). J’aimais l’époque qu’ils évoquaient dans leurs œuvres même si Schulz n’a rien d’un « réaliste ». Ses nouvelles sont intemporelles et surtout, pour quelqu’un qui n’aime guère le fantastique, elles le mettent en relief de belle façon. Et puis la sensualité de ces auteurs me touche. Je voyais aussi les spectacles de Tadeusz Kantor, les films de Wajda et donc ma grand-mère devenait un personnage de fiction. Cela nous changeait de la réalité de cette femme assez difficile à vivre.
En yiddish, il y a une expression avec laquelle on pourrait résumer la mentalité de mes parents. C’est : « Habi me lebt », pourvu qu’on vive en français. À partir du moment où vous vivez, ça va. Il y a assez de catastrophes dans le monde. L’essentiel, c’est de vivre.
Norbert Czarny
Dans Les valises, vous dépeignez également quelques moments de vie de votre grand-père colporteur et à travers lui ceux des « errants et fugitifs » qu’il a côtoyé dans différents lieux du monde…
Norbert Czarny : Il n’était pas colporteur à proprement parler, mais il aimait vendre, donc négocier, discuter, vanter un objet. C’était pour lui tout un art de vivre. Parmi les gens qu’il rencontrait ainsi, beaucoup lui ressemblaient.
Parmi ces personnes qui lui ressemblaient et dont vous racontez le récit, se situe « Le Heisericke », un habitant de Lodz, souvent nostalgique du temps où il était fortuné et de la carrière de ténor qu’il aurait pu avoir. À la différence de ce dernier, vos parents et grands-parents étaient tournés vers l’avenir malgré la tragédie qu’ils ont vécu durant la guerre. Comment l’expliquez-vous ?
Norbert Czarny : Je crois qu’une de nos particularités à mes parents, ma sœur et moi, c’est qu’on n’a aucun regret, aucun remords. On ne se retourne jamais sur ce qui a été, ça ne sert à rien. Les choses sont ce qu’elles sont. Par exemple, la richesse n’a jamais été un sujet pour mes parents. Ce qu’il fallait, c’est qu’ils aient ce qu’il faut pour que leurs enfants soient bien élevés, qu’ils aient de bonnes notes à l’école, qu’ils vivent sans trop de soucis matériels. Ils avaient une sensibilité ou une mentalité de survivant. En yiddish, il y a une expression avec laquelle on pourrait résumer la mentalité de mes parents. C’est : « Habi me lebt », pourvu qu’on vive en français. À partir du moment où vous vivez, ça va. Il y a assez de catastrophes dans le monde. L’essentiel, c’est de vivre.
Si mon père avait pu choisir son métier, il aurait probablement été sourcier. Parce que lors de son enfermement dans les camps, il a eu un de ces métiers, qui consistait à chercher de l’eau dans la campagne. Ça faisait partie des choses qui lui plaisaient. Il n’a pas parlé de beaucoup d’autres métiers. Il a exercé le métier de tailleur par nécessité. Il aurait pu devenir plombier, mais cela aurait supposé qu’il reste à Brive-la-Gaillarde, qu’il travaille avec mon oncle. En ce qui concerne ma mère, je n’ai aucune idée de ce qu’elle aurait fait comme métier parce qu’il ne faut pas oublier que quand la guerre est arrivée, elle avait 8 ans. C’est un moment où sa vie était vraiment risquée. Ce qui est certain, c’est que ce sont des vies qui ont été bousculées…
Lire aussi : « Mains, fils, ciseaux » de Norbert Czarny, le livre des vies bousculées par la guerre
« Le Heisericke » (l’enroué en français), dont je parle dans Les Valises, était de ces fréquentations de mon grand-père. Il tenait une boutique, je préfère dire une sorte de cabane, à proximité de la gare routière de Tel Aviv et vendait de la seconde main, des objets glanés ici et là. Il parlait avec nostalgie de sa ville natale, mais c’était une pure fiction. Un grand film de Wajda, La Terre de la Grande Promesse, évoque Lodz à la fin du XIXe siècle. Certes, des fortunes s’y bâtissent, comme à Manchester, grâce au textile, mais pour l’essentiel la misère règne, l’exploitation des plus pauvres est la règle, et notre « enroué » qui se rêvait fortuné racontait des histoires. Moi, j’écoutais parce que j’aime les mythomanes et les rêveurs. Les mythomanes et les rêveurs, on en trouve pas mal chez Bruno Schulz, sont des êtres qui ne font pas de mal. Ce sont des doux, des oiseaux posés sur la branche.
En proposant à partir de leur subjectivité un monde ou une vision du monde, les écrivains et plus globalement les artistes ne sont-ils pas des rêveurs, voire des mythomanes ?
Norbert Czarny : Si, bien sûr. Mais tous ne sont pas des rêveurs. Ils ont des ambitions, ils peuvent être calculateurs, cyniques, et partant, déplaisants. Mais dans le cas général, je pense que les vrais écrivains et artistes sont dépassés par leur œuvre. Proust, Joyce ou Musil sont morts sans vraiment achever ce qui était bien plus grand qu’eux.
Le conteur entraîne, enchante. Le romancier peut jouer sur des ruptures de rythme, sur la réflexion concernant le genre qu’il pratique. Diderot peut être les deux à la fois. Dumas est davantage conteur et Claude Simon romancier.
Norbert Czarny
Vos deux grands-parents étaient des conteurs fabuleux dont les récits enchantaient l’enfant que vous étiez. Qu’est-ce qui vous plaisait tant dans leurs récits ?
Norbert Czarny : Ils n’étaient pas exactement des conteurs. Mon père l’était et il mettait en relief ce qu’ils racontaient. C’est différent. Ma grand-mère revenait sans cesse sur ses malheurs, sur l’hostilité de sa cousine ou d’autres et elle avait une vision bien à elle de son temps. J’ai l’impression que sa cousine Dora était plus mauvaise qu’Hitler dont la politique lui a causé quelques soucis. Quant à mon grand-père, il me donnait à rêver en montant dans des trains qui traversaient l’Europe, en ce début des années soixante, pour aller jusqu’en Israël en prenant le bateau à Naples, Athènes ou Istanbul. Les noms des cités italiennes et yougoslaves, sur les plaques des wagons me donnaient l’illusion que je partirais un jour. Mais en avais-je vraiment envie ?
Quelles différences établissez-vous entre un conteur et un romancier ?
Norbert Czarny : Le conteur entraîne, enchante. Le romancier peut jouer sur des ruptures de rythme, sur la réflexion concernant le genre qu’il pratique. Diderot peut être les deux à la fois. Dumas est davantage conteur et Claude Simon romancier. Il y a une forme de légèreté, d’envie de séduire chez le conteur ; le romancier serait plus penseur ou pensif. J’ai une préférence pour le conteur, mais je lis davantage de romanciers.
La lecture des Valises permet également d’entrevoir votre goût pour les mythes et les légendes. Qu’est-ce que vous aimez dans les mythes et légendes ?
Norbert Czarny : Alors je n’aime pas trop les mythes et légendes, sinon les légendes inventées. Je peux lire L’Odyssée, m’intéresser à la figure d’Ulysse, à celle du Cyclope ou d’Eumée qui guide le mendiant déguisé, mais cela ne me touche que dans la mesure où je les perçois au présent. Quant aux mythes, proprement dits, je ne les lis pas assez souvent pour m’en pénétrer. Là aussi, Antigone, Œdipe ou les héros bibliques m’intéressent pour ce qu’ils disent de notre moment (comment résister, comment se débrouiller avec sa famille).

Qu’est-ce qu’une légende inventée ?
Norbert Czarny : Comme j’aime les mythomanes, j’aime les histoires qu’ils inventent pour se rendre plus heureux, pour nous faire croire des choses qui ne tiennent pas la route.
Pendant longtemps, la transmission des mythes et légendes s’est faite uniquement à travers l’oralité que certains romanciers, dont Rabelais et Cervantès ont essayé de retranscrire dans leurs œuvres. Quelle en est la raison d’après vous ?
Norbert Czarny : Je n’ai pas de réponse sur ce point. Sinon que l’oralité est ce que nous partageons tous. Pour partir du plus simple, là encore, n’oublions pas que le lieu de la rencontre, à travers les temps, c’est l’auberge, la gargote, le café : dans Don Quichotte, c’est une évidence, dans Jacques le Fataliste tout autant, et dans certains romans de Céline, un bouge londonien sert de cadre. On passe sur les salons des Lumières, sur les banquets du Satyricon, etc.
L’oralité est-elle de la littérature ?
Norbert Czarny : Sans aucun doute. Sans quoi, on ne comprend rien aux textes antiques et on oublie les traditions en vigueur sur d’autres continents que le nôtre.
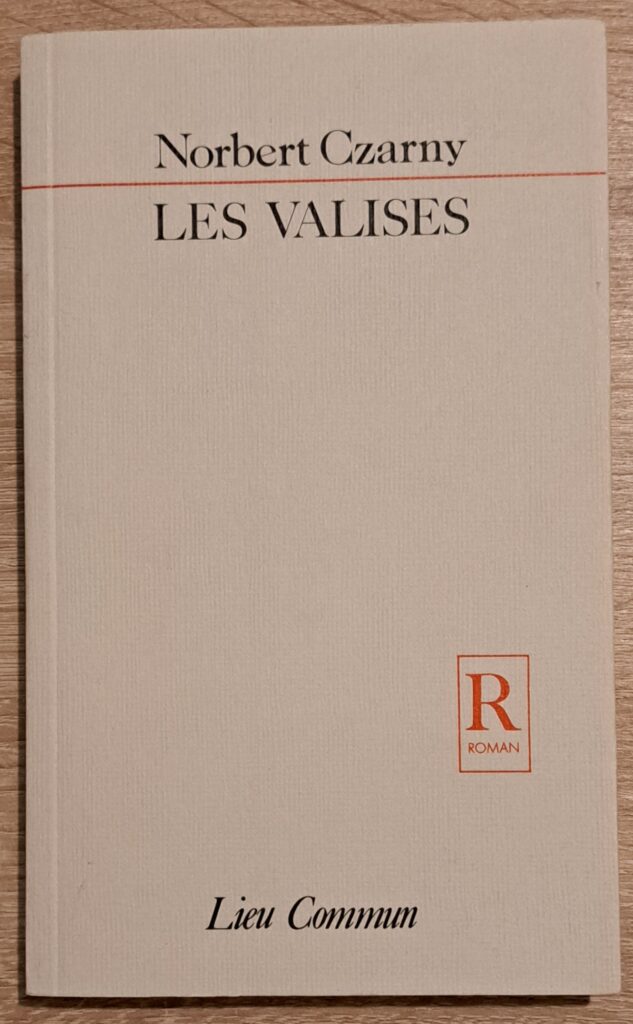
Comment préserver cette oralité à laquelle vous tenez comme l’atteste la reproduction du langage oral de votre grand-mère dans Les Valises ?
Norbert Czarny : Je ne supporte pas le pseudo yiddish que l’on entend dans des films comme Les Aventures de Rabbi Jacob, dans certains spectacles humoristiques que je préfère ne pas nommer ou dans la bouche de personnes qui imitent. Pour moi, ce n’est pas mieux que les imitations d’accents chinois ou africains. Sous couvert d’humour, ils déforment, voire méprisent. J’ai donc cherché le débit et l’accent d’une obsessionnelle, persuadée qu’on lui voulait du mal. C’est l’accent de Mémé, tel que je l’ai entendu, tentant de le transcrire.
Quelle place accordez-vous à la langue d’un auteur ?
Norbert Czarny : La seule place qui vaille. Rien ne tient sans la langue que l’on s’est forgée. Chaque écrivain commence par là et continue de même jusqu’au bout. C’est pourquoi j’aime aussi bien la sobriété d’un Yves Ravey que la profusion d’un Philippe Bordas. Je pourrai évoquer bien des écrivains que je lis d’abord parce qu’ils ont une langue. C’est le cas d’Olivia Rosenthal dont je lis en ce moment, avec enthousiasme, Une femme sur le fil. Je lis cette autrice depuis longtemps et je suis toujours impatient de découvrir son nouveau livre. Je sais que ce sera riche, surprenant, ouvert, que ça donnera à penser, que son discret humour et sa mélancolie me toucheront.
Outre le silence et la poésie, votre langue d’écriture a la particularité d’être implicite par moments. C’est le cas notamment dans Les Valises et Mains, fils, ciseaux. Quelle en est la raison ?
Norbert Czarny : Je pense que ne pas nommer directement, mais par allusions, par détour est la meilleure façon de nommer. Je l’ai appris de Danilo Kiš qui dans Sablier ne parle jamais de l’étoile jaune que porte le père au revers du veston : il parle d’une grosse fleur jaune. Et puis j’ai retrouvé cela chez Calvino : cette représentation de la réalité, impératif des années 45-50, Calvino a tenté de la donner de façon indirecte, tel Persée affrontant la Méduse : « C’est toujours dans le refus de la vision directe que réside la force de Persée, mais non dans un refus de la réalité du monde des monstres où il lui a été donné de vivre, une réalité, qu’il porte avec lui, qu’il assume comme son propre fardeau. »
Louis-Ferdinand Céline qui considérait le précepteur du roi Henri III et traducteur Jacques Amyot, comme « le véritable initiateur de la stérilisation du français1 » en une langue extrêmement codifiée par quelques érudits a toujours plaidé en faveur d’une littérature écrite dans un français vivant, réellement parlée par celles et ceux dont les trajectoires sont mises en scène dans ses romans. Une telle écriture est-elle encore possible à notre époque entre autres marquée par l’industrialisation de la littérature ?
Norbert Czarny : Les écrivains n’ont pas le choix mais je ne suis pas sûr que l’avis de Céline soit le plus juste : je ne sais pas ce qu’est un français réellement parlé, on reconstruit forcément… Écrire, c’est aller contre une production ou la fabrication d’un produit. Même si le produit marche du feu de Dieu, à en juger par les affiches dans le métro et les queues dans certains salons du livre. Être un écrivain, c’est accepter d’être minoritaire, isolé, voire ignoré ou presque.
Pour celui ou celle qui écrit, elle une sorte d’oreiller. Antonio Lobo Antunes, un auteur portugais, disait ceci : « Chacun de mes livres, c’est comme un oreiller sur lequel je me repose. »
Norbert Czarny
Comment préserver les littératures de cette industrialisation globalisée ?
Norbert Czarny : Elles ne peuvent rien contre ce phénomène qui ne date pas d’hier. Lire à ce propos Les Illusions perdues de Balzac. Mais il faut continuer et pour les lecteurs, faire les choix qui s’imposent entre les livres et les produits.
Les deux ouvrages que vous avez publiés ont en commun de mettre en exergue votre quête d’informations avant l’écriture. Quelle place occupe la documentation dans votre travail littéraire ?
Norbert Czarny : Plutôt que me documenter, je dirai que je rêvasse, sans que ce suffixe du verbe soit péjoratif. Et puis, comme je prends de l’âge, que j’ai beaucoup lu, entendu, vu et appris, je me sers de ce que je sais, pour tout oublier en quelques phrases écrites. La documentation est importante, si on l’oublie.
Un dernier mot sur la littérature ? Que peut-elle dans notre société ?
Norbert Czarny : Je crois qu’elle ne peut strictement rien. Si elle pouvait, les gens ne voteraient pas pour de dangereux démagogues, les racistes et autres haineux ne seraient pas aussi puissants et influents, des hommes ne seraient pas brutaux envers les femmes, les plus fragiles, et une forme d’harmonie existerait. Nous en sommes plus que loin et je crains même que nous régressions, faute de penser notre Histoire et ses désastres. Une terrible forme d’oubli nous atteint. Mais je suis peut-être trop pessimiste ? L’influence de Flaubert ?
Même pour celui ou celle qui écrit, la littérature ne peut strictement rien ?
Norbert Czarny : Pour celui ou celle qui écrit, elle est une sorte d’oreiller. Antonio Lobo Antunes, un auteur portugais, disait ceci : « Chacun de mes livres, c’est comme un oreiller sur lequel je me repose. » Je suis d’accord avec cela. Lorsqu’on écrit, on se repose sur un oreiller. Là ce que j’ai envie d’écrire, c’est un livre sur mon service militaire. Au service militaire, j’ai fait pas mal de rencontres parce que je n’étais pas à Paris, ni dans une fonction pour intello. J’étais dans une caserne en Alsace où j’ai rencontré un peu le tout-venant. J’y ai rencontré notamment des gens de peu, des gens démunis qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait dans un contexte heureusement très pacifique parce qu’à l’époque, on ne risquait rien. J’y ai aussi vécu une histoire d’amour qui a été très importante…
1 Exercices de lectures. Marc Fumaroli.
