À la lecture du titre du nouveau roman de Robin Josserand, on s’attendait à lire une énième histoire d’amour adolescente avec une entame et une fin convenues, stéréotypées. Pourtant, dès les premières pages du roman, on est agréablement surpris devant les choix narratifs du romancier français, qui se détache graduellement de tous les codes des récits mettant en scène des histoires d’amour adolescentes pour dépeindre les maladresses, l’esseulement et la sexualité, quasiment invécue, de ce jeune double littéraire, qui habite Le Creusot. Dans cette ville où tout lui semble morose mis à part le bel et inaccessible « Arture » dont il s’est entiché lors du premier cours, la littérature deviendra un refuge pour le jeune protagoniste. Celui-ci s’engagera d’ailleurs avec finesse à la réécriture de certains épisodes du passé pour mieux les « éclaircir », mieux les vivre. Entretien avec Robin Josserand.
Vous publiez à l’occasion de la rentrée littéraire Un adolescent amoureux, un opuscule qui retrace le quotidien de Robin, un adolescent quelque peu original qui habite Le Creusot. Quelle est la genèse de ce roman ?
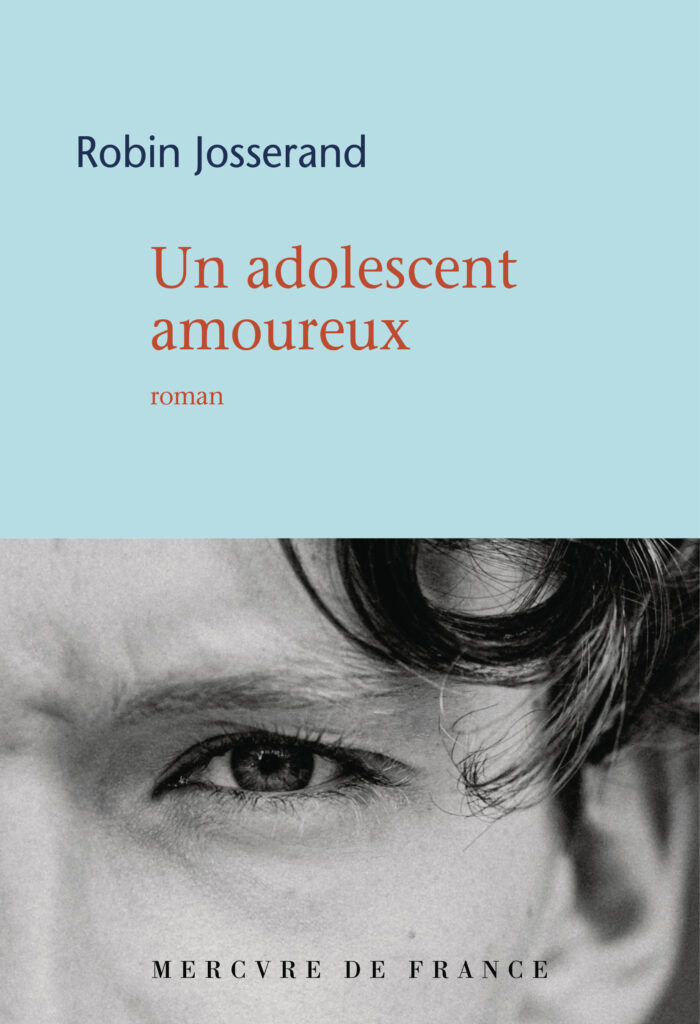
Robin Josserand : Un Adolescent amoureux est le premier texte sur lequel j’ai travaillé lorsque j’ai commencé à écrire. C’est-à-dire lorsque j’ai pris la décision d’écrire sérieusement. Il m’est alors apparu que je ne pouvais rien écrire d’autres que cette adolescence erratique. Que cette histoire constituait un point de départ. C’était nécessaire, ontologique. Je ne crois pourtant pas du tout au pouvoir réparateur de la littérature, mais il y avait là une évidence ; aucun autre livre n’était alors possible. Parce qu’il s’agissait aussi de se confronter au romanesque, un adolescent « faisant corps » avec l’objet aimé, le singeant, s’inventant une fiction pour survivre. J’ai ainsi travaillé sur ce texte, que j’ai finalement laissé de côté afin d’écrire ce qui est devenu mon premier roman, Prélude à son absence. À la parution de ce dernier, j’ai repris Un adolescent amoureux. Il était temps de solder cette histoire.
Construit sous forme de fragments, ce roman met notamment en exergue la fascination de Robin pour un jeune homme de son lycée dont il est éperdument amoureux…
Robin Josserand : Tout ce que je peux dire, c’est que cet adolescent objet du désir a tout pour plaire : il est plus âgé, c’est un voyou, un cancre, il a du succès auprès des filles. L’homosexuel de dix-sept ans ne peut être que fasciné par cette figure qui incarne la virilité, la masculinité à son plus haut degré, absolument grisante. Mes livres sont, à chaque fois, des exercices d’admiration. Une admiration qui constitue pour moi un point nodal, un sujet primordial qui me fascine et m’interroge.
Un Adolescent amoureux met aussi en exergue les premiers émois sexuels maladroits de Robin, quitte à rompre avec le romantisme surjoué de certains récits mettant en scène des amours adolescentes…
Robin Josserand : Oui, c’était ma volonté. Je souhaitais que cet adolescent amoureux, dont le titre annonce justement un romantisme facile – il est d’ailleurs question, à un moment, des Fragments d’un discours amoureux, mais pour s’en détourner, pour ne pas les lire -, soit un adolescent qui aime mal, à côté. C’est un amour solitaire, résolument triste, qui est tout de même le lot de beaucoup d’amours adolescentes. Je voulais modestement montrer ce que c’était que d’être un homosexuel tiraillé par son désir dans un lieu où celui-ci n’existe pas. Dès lors, comment aimer – ou plutôt, comment survivre à son désir ? Sous-entendu lorsque cet amour ne peut avoir d’inscription concrète dans le réel. Les amours hétérosexuelles contrariées de cet âge ont au moins cette maigre consolation : les autres savent que vous souffrez. Là, vous êtes absolument seul.
Le personnage de Robin semble entretenir une certaine forme de marginalité liée entre autres à sa condition et à son désamour du Creusot qu’il rêve souvent de quitter. Quelle en est la raison ?
Robin Josserand : Parce que cet amour-là, dans une ville de province et ouvrière au début des années 2000, n’existait pas. C’est donc une marginalité subie et non souhaitée ; ni héroïque ni revendiquée. Une solitude triste. Le narrateur tient ainsi cette ville pour responsable de sa marginalité ; un lieu dans lequel il assiste aux histoires des autres et où il voit bien à quel point l’amour peut y être formidable. Alors il s’agit de faire croire, de faire semblant d’être comme les autres.
Comment expliquez-vous cette marginalité entretenue par les protagonistes de vos deux romans ?
Robin Josserand : Dans les deux cas, ils désirent des images, des projections, des garçons dont ils savent qu’ils ne peuvent rien attendre en retour. Ils admirent. Ils s’enlisent dans un désir impossible, non sans une certaine jouissance masochiste – moins pour Un Adolescent amoureux, qui est tout de même plus mélancolique. Dans un cas, le narrateur s’acharnera, dans l’autre, il s’attachera à se transformer en l’objet du désir. Mais peut-être sont-ils aussi un peu fiers de cette marginalité. Ce sont des narrateurs qui se positionnent par rapport à leur désir qui, de fait, les isole et renforce cette solitude.
Lire aussi : « Prélude à son absence » de Robin Josserand, l’art de la contemplation
Quid du désamour de Robin pour à la fois Le Creusot et ses habitants ?
Robin Josserand : Quelques semaines après la parution de mon premier roman, je me suis rendu dans Le Creusot pour une rencontre avec des lecteurs. À la fin, le libraire m’a tendu un exemplaire et un mot : n’ayant pu être présent, mon ancien professeur de français me demandait d’y rédiger une dédicace à l’attention des élèves. Le livre devait intégrer la petite bibliothèque du lycée. Compte tenu de la nature du texte, je préférais plutôt le destiner à mon professeur. Peu après, je suis passé devant le vieil établissement abandonné où j’avais été élève ; depuis quelques années, les cours se tenaient dans de nouveaux bâtiments. Des engins détruisaient ce qu’il restait de la structure, la façade avait disparu, mais les salles étaient encore intactes. Je ressentais une réelle jouissance devant cette scène de destruction. C’était beau. Dans le train qui me ramenait à Lyon, je déplorais mon manque de courage, avec cette sensation amère d’être passé à côté d’un geste puissamment symbolique ; le moi adulte écrivant au moi adolescent via le truchement d’un roman qui aurait enfin trouvé sa juste place. Un entremêlement des voix, de l’enfant, de l’adulte et de l’adolescent. Mais j’ai réalisé, peu après, que cette dédicace existait déjà : j’étais en train d’écrire ce livre, que j’ai ainsi songé à adresser à mes anciens et à mes nouveaux camarades.
Le dernier chapitre du livre permet d’entrevoir la naissance d’une vocation chez Robin qu’est l’écriture. La pratique de celle-ci lui permet notamment de réécrire certains épisodes du passé. La littérature est-elle aussi une affaire de réécriture ?
Robin Josserand : Elle peut l’être, oui. La fiction comme un palimpseste à même le réel. Ça n’est pas sa fonction exclusive, mais elle le peut. C’est en tout cas l’une des natures de l’autofiction, venir jouer avec le réel afin de le corriger à sa guise. C’était l’idée de ce livre, donner un supplément de courage au réel. Et puis écrire reste une réécriture de soi, de son histoire, et des œuvres qui nous constituent. Ainsi, à la fin du roman, le narrateur va entrer en écriture en s’inspirant d’une scène « ratée » du livre – dans le sens où il rate son éveil au désir ; désir et littérature, encore une fois liés – afin d’en faire une réussite. Un passage à l’acte. C’est une question véritablement passionnante. L’écriture comme du soi distillé partout, de près ou de loin, et surtout de loin en loin. Alors, toute littérature devient autofiction, ce que je crois. Cela pourrait ainsi constituer une belle définition. C’est quoi la littérature ? Une réécriture.
Quel livre vous a poussé à vous lancer dans l’écriture ? Est-ce Prisonnier au berceau, le roman de Christian Bobin cité en épigraphe ?
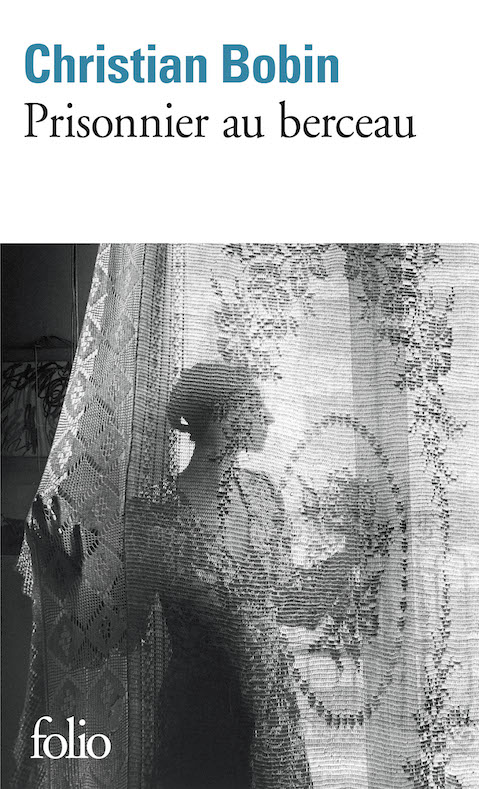
Robin Josserand : Je ne crois pas qu’il y ait un seul livre qui m’ait poussé à écrire. Je dirais plutôt qu’un ensemble de textes, à peu près au même moment, vers l’âge de seize ans, m’a fait comprendre ce qu’était, ou plutôt ce que pouvait être la littérature. Parmi eux, il y avait Kafka, Madame Bovary, Genet et les nouvelles de Salinger. Commencer à écrire, c’est singer, imiter, voler la voix des autres. Alors j’écrivais – ou plutôt je réécrivais -, ce que j’étais en train de découvrir – je n’ai, en revanche, aucun souvenir des circonstances dans lesquelles je suis tombé sur ces textes.
Peut-être un professeur ? Kafka, c’était la fulgurance, l’extrême précision des images, Flaubert, la cruauté et l’humour, Salinger, cette sensation de rien dans laquelle passait tout, Genet, la beauté, la poésie, la langue… Tout ça était encore de l’ordre du jeu, de l’enfance. C’est-à-dire que ces lectures étaient d’une telle puissance – je pense d’ailleurs à cette phrase de Littell à propos de l’incipit de Notre-Dame-des-Fleurs : « Maintenant, je suis tranquille, je sais que je vais aller de merveille en merveille » – que je n’avais pas d’autres choix que de les absorber, avec cette naïveté, ou cette arrogance adolescente, qui faisait que ça ne me semblait pas si difficile à faire. Alors j’écrivais de mauvaises pages du Journal, des personnages qui ressemblaient à la famille Glass. Ce fut donc plutôt une espèce de corpus, des textes fonctionnant ensemble, un réseau, des contrepoints, qui firent émerger ce que pouvait être, à mes yeux, la littérature. Après, évidemment, tout consista à faire ma mue et à m’en défaire. Mais il y avait comme un compagnonnage, une petite tribu secrète qui m’accompagnait partout.
Comment qualifierez-vous ce roman ?
Robin Josserand : Un Adolescent amoureux est une autofiction de formation. Une éducation sentimentale. Un réveil un peu difficile. Une adolescence pénible. Le lot de tout adolescent amoureux…
