La prophétie de Dali est un roman qui se lit avec attrait. À la fois grâce à l’écriture envoûtante du primo-romancier Balla Fofana et l’acuité de son discours sur l’école où son double littéraire acquerra maints savoirs utiles à sa construction en tant qu’individu et membre d’une société.
La griotte Dali Kouyaté n’a rien d’une cantatrice dont les mots sont uniquement employés pour flatter quelque notable ou raconter artistement les grandes épopées du Mali. Son leitmotiv est de raconter le pouvoir émancipateur de l’école au jeune Balla, nouvellement arrivé en France avec sa parentèle, en quête d’une vie meilleure. Au-delà de ce discours salutaire sur l’école, La prophétie de Dali est un texte intelligent qui nous amène à réfléchir sur la préservation urgente des traditions orales africaines, à l’heure de la globalisation culturelle. Entretien avec Balla Fofana.
Pourquoi écrivez-vous ?
Balla Fofana : Écrire est quelque chose que je fais depuis une vingtaine d’années, avant même d’avoir l’ambition de publier des livres. C’est un moyen d’extérioriser, de mettre à distance les vécus et ressentis pour mieux les évacuer.
Comment écrivez-vous ?
Balla Fofana : Ce sont d’abord des idées qui me viennent et que je prends en note. C’est après que je transforme ces idées pour pouvoir en faire un livre.
Sur quel support écrivez-vous ?
Balla Fofana : Sur mon ordi et sur mon téléphone.
Est-ce que vous faites de la documentation avant d’entamer l’écriture d’un texte ?
Balla Fofana : Ça dépend du texte et s’il y a des visées informatives ou pas, mais c’est d’abord avec émotion que j’écris.
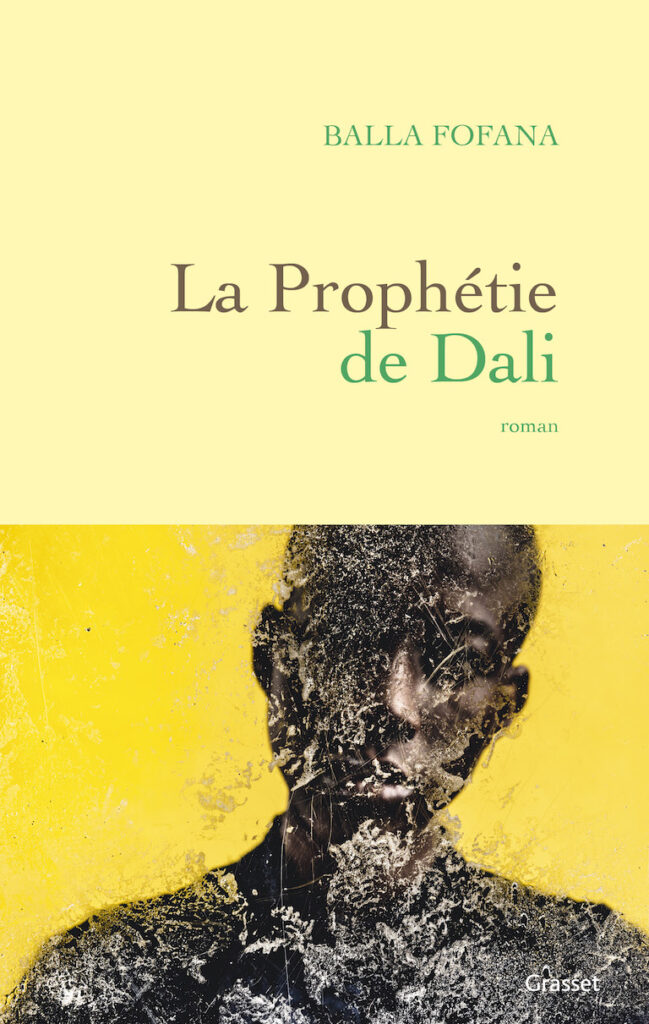
La prophétie de Dali, votre premier roman est parsemé de références à plusieurs périodes de l’histoire du Mali. Est-ce que vous avez procédé à de la documentation historique pour ce livre ?
Balla Fofana : Oui, mais cela a eu lieu dans un second temps. Ça veut dire que c’était plus pour faire de la vérification parce que le texte devait être publié. Sinon, ce sont des références avec lesquelles j’ai grandi.
La prophétie de Dali retrace le parcours du jeune Balla aux côtés de sa parentèle entre le Mali et la France. Quelle est la genèse de ce texte ?
Balla Fofana : La genèse de ce texte est un article publié dans Libération en 2015 (Le syndrome du survivant). Il m’avait valu beaucoup de retours positifs et plusieurs propositions d’écriture de livres. Mais en 2015, je ne sentais pas forcément prêt, ce n’était pas le moment de travailler sur un livre. Mais avec le temps et le confinement, j’ai pu me poser pour réfléchir et écrire La prophétie de Dali.
Votre livre est habité par la figure de Nâ, une mère courage à qui vous rendez un vibrant hommage…
Balla Fofana : Cette mère courage, c’est Wassa Magassa, ma mère. Une femme avec des idéaux très forts, qui va agir littéralement selon ses aspirations. Quand son mari la quitte, elle ne va pas se morfondre sur son sort. Elle va plutôt essayer de contrôler sa destinée et celle de ses enfants. Pour cela, elle va quitter son pays et rejoindre la France pour essayer d’assurer un avenir à ses enfants. C’est quelqu’un qui croit beaucoup à l’école et qui a la frustration de ne pas y avoir été durant son enfance. C’est quelque chose qu’elle aimerait réparer à travers ses enfants.
Chaque individu a été confronté à des prophéties, joyeuses comme malheureuses. Ce qui nous incombe en tant qui responsabilité, c’est de faire de notre mieux pour faire advenir la prophétie qui nous sied…
Balla Fofana
Diriez-vous que c’est un texte sur la construction de soi ?
Balla Fofana : Oui, c’est un texte sur la construction de soi. C’est un texte qui parle beaucoup des attentes de ceux qui ont émigré, qui arrivent dans un pays dont ils ne maîtrisent pas les codes et prennent de plein fouet la conséquence de ne pas savoir lire ni écrire dans un pays où tout est basé sur l’écrit. Ils se voient fermer des portes, font face à beaucoup d’incompréhensions, des moments de violence verbale ou symbolique dans les institutions. Ils ont par exemple en eux le traumatisme des files d’attente à la préfecture où ils arrivent avec toutes les pièces, mais on leur dit qu’il en manque d’autres. Et comme ils ne savent ni lire ni écrire, et donc pas capable de les rassembler, ils vont devoir revenir à nouveau. C’est fort de ce genre d’expérience qu’ils éprouvent au quotidien qu’ils vont recommander à l’ensemble de leur famille de s’accomplir dans les savoirs dont ils ont été éloignés et qui explique aussi en partie les difficultés qu’ils ont dans les pays où ils ont émigré.
« La prophétie de Dali », pourquoi avez-vous choisi de titrer le livre ainsi ?
Balla Fofana : Parce que c’est joli et que c’est une prophétie qui va être déterminante pour l’enfant. À la fois dans son parcours et la perception qu’on a de lui. Dire à quelqu’un qui est vu comme un paria qu’il est promis a un grand avenir auquel personne ne s’attend est courageux. C’était aussi pour montrer le poids de la parole sur les individus. Je pense que chaque individu a été confronté à des prophéties, joyeuses comme malheureuses. Ce qui nous incombe en tant qui responsabilité, c’est de faire de notre mieux pour faire advenir la prophétie qui nous sied et de ne pas laisser des personnes extérieures tracer notre destin. Ça, c’est très important. On entend tous les jours des personnes dire à d’autres : « Tu n’y arriveras pas, tu n’es pas assez bon, tu n’as pas ceci, tu n’as pas assez cela. » Croire en ce genre de mots peut engendrer une prophétie. Autant essayer de donner raison à ceux qui vous veulent du bien et qui projettent des choses positives pour vous.
Peu importe la forme ou l’emballage de la connaissance, ce qu’il faut, c’est essayer de l’acquérir, d’aimer l’acquérir sans faire de hiérarchies.
Balla Fofana
Est-ce qu’il y aurait également une volonté de rappeler, voire d’ennoblir en littérature les traditions cultuelles et culturelles ouest-africaines, qui ont souvent été tournées en dérision ?
Balla Fofana : Je pense qu’il n’y a pas une volonté de les ennoblir. Il y a dans le livre une phrase de Dali Kouyaté, qui est très importante. Elle dit que la tradition orale et l’écriture sont deux cours d’eau qui se complètent, qui s’abreuvent à la même source et cette source-là, c’est la connaissance. Peu importe comment on acquiert la connaissance, ce qui est important, c’est de l’avoir et d’essayer de répondre aux problèmes avec cette connaissance. Donc, peu importe la forme ou l’emballage de la connaissance, ce qu’il faut, c’est essayer de l’acquérir, d’aimer l’acquérir sans faire de hiérarchies. C’est plutôt ça le propos. Toute forme de connaissance est bonne à prendre. Le livre est plutôt une ode à la culture et à l’éducation. Plus on en possède, mieux on se porte.
Gardien des cosmogonies africaines, le griot a longtemps eu un rôle polysémique dans de nombreux pays sur le continent. « Passeur d’histoire » comme vous l’écrivez, il est aussi le garant de la cohésion sociale. À l’heure de la globalisation culturelle, croyez-vous à la survivance de cette figure ?
Balla Fofana : C’est un vrai défi qui est lancé à cette organisation sociétale. Ce sont des personnes qui sont mises en concurrence avec le marché de l’attention, du numérique et des nouvelles technologies. Adam Ba Konaré, l’historienne, qui a aussi été la première dame du Mali, a souvent dit qu’il y avait de plus en plus de passeurs d’histoire, c’est-à-dire des personnes comme les griots qui portent des histoires en elles, qui se meurent de ne pas avoir d’oreilles pour les écouter. C’est un vrai drame sur la question des traditions orales… C’est un matériau vivant qu’il faut essayer de préserver, car il permet aux individus de s’élever par la connaissance. On ne peut jamais se réjouir de voir ces gens s’évanouir ou être moins écoutés, moins suivis, voire boudés par les populations. Il y a quelque chose à inventer pour maintenir ce patrimoine qui est très important.
L’oralité a une place très importante dans votre livre. Est-ce un fortuit ou délibéré ?
Balla Fofana : Je ne pense pas que ça puisse être une coïncidence. L’oralité est la première source d’accès à la connaissance et à la culture. C’est quelque chose que je porte en moi, qui fait que j’arrive à traduire en littérature le style griotique. Si j’arrive à le faire, ce n’est pas parce que j’ai un talent quelconque, mais parce que j’ai baigné là-dedans. C’est pour moi, un style flamboyant et très poétique en soi. C’est un style qui est fondamentalement littéraire. Il ne revendique pas tous les jours ce statut, mais il l’est fondamentalement. La capacité à improviser des chansons et des poèmes est un talent littéraire, artistique, qui n’est pas donné à tout le monde. Retranscrire ça en littérature ne demande aucun effort, parce que c’est déjà de l’art et l’art arrive toujours à cohabiter avec l’art.
Pour moi, le fondement de la littérature, c’est la poésie. Et la poésie est partout. Elle est dans les récits écrits, dans les improvisations, dans les dialogues…
Balla Fofana
Un texte a-t-il besoin d’être écrit pour être considéré comme étant de la littérature ?
Balla Fofana : Pour moi, non. De toute façon, moi, j’écris des textes pour qu’ils soient déclamés, et non qu’ils soient lus dans la tête. Quand j’écris, je lis à voix haute. J’espère que les gens liront le livre à voix haute parce que j’écris avec une musicalité et une musique. Ce qui compte pour moi, c’est que le texte sonne juste oralement.
Est-ce pour cela que nous décelons quelque hommage au rap et au slam ?
Balla Fofana : Oui, bien sûr. On est riche de beaucoup de choses qui s’entrecroisent et font partie du processus créatif. Le but, ce n’est pas d’en hiérarchiser une, de dire que la littérature est au-dessus de tout, mais qu’au contraire, elle se nourrit de plusieurs arts. C’est ce qui fait qu’elle se réinvente. Pour moi, le fondement de la littérature, c’est la poésie. Et la poésie est partout. Elle est dans les récits écrits, dans les improvisations, dans les dialogues, dans une chanson, dans un slam, dans la vie quotidienne… Elle est partout. Ce qui est important, c’est la puissance du verbe. Le verbe, c’est le feu de la création, il est pour moi au-dessus de la littérature. C’est de là que tout part. C’est pour ça que j’écris pour proposer une littérature qui soit déclamée et qui rende hommage à la puissance du verbe. C’est par le verbe que l’enfant se libère, quitte le mutisme. Quand il prend en compte la puissance du verbe et qu’il lui fait honneur, il s’aperçoit qu’il n’y a rien de plus utile que le verbe et que c’est grâce à lui qu’il deviendra un passeur d’histoires.
La langue a un rôle très important dans votre livre puisqu’elle est à la fois excluante et nécessaire pour faire communauté. Je pense notamment aux élèves en classe de perfectionnement.
Balla Fofana : La langue est une façon de voir et de décrire le monde dans sa complexité. Plus on maîtrise de langues, plus on est riche de visions du monde. Ce qui est très dur dans les situations d’exil, c’est qu’il y a une invalidation de votre langue et donc de votre vision du monde. Quand vous essayez d’accéder à la nouvelle vision du monde qui est proposée, et que vous trébuchez, faites des erreurs ou vous trompez, c’est souvent synonyme de moqueries.
Cela crée tout un combat avec la langue pour essayer de construire au plus juste et avec ses moyens, une réalité qui vous échappe. Je pense que c’est pour cela que les langues peuvent avoir un côté excluant. Ce n’est pas tant la langue en elle-même qui est excluante, mais les individus qui la maîtrisent et vous jugent par rapport à vos capacités dans une langue. Ils vous jugent sans jamais prendre acte de l’effort qu’il y a à apprendre une nouvelle langue tant pour eux, c’est naturel. C’est ce qui crée les situations d’exclusion.
Il y a des millions d’individus dans ce pays qui ont vécu ou vivent dans des environnements bilingues, voire même trilingues des fois. C’est une réalité française, une réalité à normaliser.
Balla Fofana
Votre livre est parsemé de mots et d’expressions en bambara. Mettre cette langue dans le livre était-il important pour vous ?
Balla Fofana : Je ne le vois pas comme quelque chose d’important. Ce serait une revendication de dire que c’est important. J’ai juste cherché à retranscrire une réalité. Ça veut dire qu’il y a des millions d’individus dans ce pays qui ont vécu ou vivent dans des environnements bilingues, voire même trilingues des fois. C’est une réalité française, une réalité à normaliser. Ce n’était donc pas pour revendiquer une langue parce qu’une langue ne se revendique pas, ça se parle. Faire coexister deux langues, c’est juste montrer la réalité que beaucoup de gens vivent au quotidien sans projet politique. Passer d’une langue à une autre, c’est aussi montrer que ce sont des personnes qui sont face à plusieurs réalités, plusieurs langues grâce auxquelles ils construisent leur langage. C’était pour souligner cela parce que c’est quelque chose qu’on voit peu dans les fictions, qu’elles soient écrites ou audiovisuelles, alors qu’on est dans des sociétés pluriethniques. C’est une réalité qui est là et palpable.
Quel est votre rapport personnel aux langues que vous parlez ?
Balla Fofana : Mon rapport aux langues que je parle est lié aux individus avec lesquels je parle. C’est d’abord affectif. Parce que c’est lié à des moments de partage avec d’autres personnes. C’est vraiment par affection que j’apprends à parler des langues, et un peu par mimétisme aussi. C’est un apprentissage qui me permettra d’accéder à d’autres réalités, d’autres visions du monde aux côtés des personnes que j’affectionne.
Quels sont les textes et les auteurs qui vous ont permis de vous construire intellectuellement et humainement ?
Balla Fofana : Il y a la tradition orale. Toutes les épopées africaines, qui ont été très importantes. Ce sont les premiers récits qui se sont figés dans mon imaginaire, avec des grandes personnalités comme Soundjata Keïta, Kankou Moussa, Golo Diarra. Il y a eu aussi la mythologie gréco-romaine. C’est une mythologie avec laquelle on pouvait faire pas mal de ponts avec les grands mythes africains. Pour ce livre, l’une des influences importantes est Amadou Kourouma, notamment son livre Allah n’est pas obligé. Le parti-pris narratif de mon livre est en lui-même un hommage à Amadou Kourouma. Dans Allah n’est pas obligé, c’est un jeune garçon qui pense en mandingue et va réussir à reconstruire son histoire au fil des pages à l’aide de plusieurs dictionnaires. Avec mon livre, l’idée est d’actualiser cette histoire avec un jeune garçon dans le même état d’esprit, mais confronté à la langue du pays dans lequel il est nouvellement arrivé. Ce que fait Kourouma dans ce livre est d’ailleurs tout à fait prodigieux : il a une écriture évolutive au fur et à mesure des pages. Il a été une grande inspiration.
La forme est un peu un élément de distinction, qui permet d’avoir un cadre, une originalité et de ne pas se perdre dans l’écriture.
Balla Fofana
Le travail formel occupe une place très importante dans l’œuvre d’Amadou Kourouma, notamment dans le livre susnommé. Quelle place occupe-t-il dans le vôtre ?
Balla Fofana : Je vois chaque livre comme une sorte d’entraînement, qui nous amène à penser la forme. Et ce que nous permet la forme, c’est d’avoir un cadre dans lequel on va essayer de sublimer l’écriture et son utilité. Ce travail sur la forme est quelque chose qu’on pense en amont, mais qui est sans cesse remis en question au fil de l’écriture. La forme est un peu un élément de distinction, qui permet d’avoir un cadre, une originalité et de ne pas se perdre dans l’écriture. Pour ce livre, je voulais écrire à hauteur d’enfant. Un enfant qui ne pense pas en français, mais qui va devoir restituer sa pensée en français.
Comment qualifieriez-vous votre travail littéraire ?
Balla Fofana : Honnêtement, je ne sais pas si c’est à moi de le qualifier. Ce que j’ai essayé de faire en tout cas, c’est un travail sur différentes langues pour créer une langue. Toutes les péripéties qui arrivent dans le livre sont mises au service de la langue et non l’inverse. Le plus dur était de ne pas perdre la voix de l’enfant pour créer une espèce de pacte avec le lecteur dès les premières lignes du livre. C’est vraiment le travail que j’ai essayé de faire en tant qu’écrivain. Mais je ne saurais pas forcément le qualifier ni le catégoriser.
La littérature vient toujours remettre de la sensibilité, de l’humanité sur des choses que le regard ou les a priori ont déshumanisées.
Balla Fofana
Avez-vous d’autres projets littéraires en perspective ?
Balla Fofana : Les perspectives sont toujours nombreuses, mais je dois admettre qu’il est encore tôt pour moi, puisque le livre est sorti il y a peu de temps.
Qu’est-ce que la littérature ?
Balla Fofana : C’est le fait de créer un univers et le rendre accessible aux autres.
Que peut-elle ?
Balla Fofana : Je pense qu’elle a la faculté de nous rendre sensibles. Le quotidien, l’actualité, le fait qu’on range tout dans des cases, nous rendent insensibles. La littérature vient toujours remettre de la sensibilité, de l’humanité sur des choses que le regard ou les a priori ont déshumanisées.
Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui ont envie de se lancer en littératures ?
Balla Fofana : Je leur dirais de venir avec un univers. Je ne pense pas que ça s’invente, mais pour l’acquérir, il faut avoir lu beaucoup de livres, écouté beaucoup d’histoires, observé beaucoup de gens. Il faut venir avec une proposition qui puisse apporter une contribution à la riche contribution qui existe déjà.
