Grande dame des lettres francophones, la romancière gabonaise Charline Effah fait son retour avec un ouvrage résolument ambitieux et politique sur les femmes réfugiées au camp de Bidibidi en Ouganda. Un texte remarquable qui clôt également son projet littéraire sur le corps des femmes.
Les trois premiers romans de Charline Effah racontaient avec minutie la vie des femmes. À la fois les injonctions et oppressions auxquelles elles sont exposées, mais aussi les combats qu’elles mènent courageusement pour s’affranchir de la tutelle masculine, qu’elle soit paternelle ou maritale. Dans Les femmes de Bidibidi, son nouvel ouvrage, à paraître à la rentrée littéraire aux Éditions Emmanuelle Collas, Charline Effah ancre son récit dans un camp de réfugiés pour relater à la fois les maux et le courage des femmes africaines, souvent les premières victimes des heurts politiques et armés sur le continent. Entretien avec une portraitiste assidue de la condition féminine.
Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?
Charline Effah : Je suis née au Gabon et j’ai grandi à Libreville au milieu d’une famille de 4 enfants dont je suis l’aînée. Après mon baccalauréat, je me suis inscrite à la faculté de lettres modernes de Libreville à l’Université Omar Bongo où j’ai obtenu une maîtrise (ce qu’on appelle Master 1 de nos jours). J’ai ensuite obtenu une bourse de troisième cycle afin de poursuivre une thèse que j’ai soutenue à l’université de Lille 3. Actuellement, je réside à Paris où j’ai fondé depuis sept ans, mon entreprise, l’Institut Diadème, un organisme de formation dédié à la professionnalisation des emplois familiaux. Je suis cheffe d’entreprise le jour et j’écris la plupart du temps, la nuit.
Pourquoi écrivez-vous ?
Charline Effah : J’écris pour aller mieux. L’écriture m’apaise dans le sens qu’elle me permet d’extérioriser, mettre les mots sur mes névroses, mes colères et mes convictions. Je n’aime pas paraître prétentieuse en disant que j’écris pour changer le monde, en revanche, je suis convaincue qu’une œuvre écrite avec le cœur, une œuvre qui relate une expérience humaine, rencontre forcément un lectorat qui se retrouve dans l’histoire qui est romancée ou qui adhère à la vision de l’autrice que je suis. Et c’est dans ce sens qu’une œuvre est capable de bousculer le lecteur, parce que l’histoire qu’elle raconte, rencontre l’histoire de celui qui lit.
Après la fabrique des personnages, je choisis le narrateur. Quand je suis certaine de ma voix narrative, je peux commencer l’écriture du roman.
Charline Effah
Comment écrivez-vous ?
Charline Effah : Le livre ou l’idée du livre, quand elle naît dans ma tête, va prendre le temps de mûrir longtemps avant que je ne décide de travailler dessus. Généralement, j’ai plusieurs idées de romans qui se bousculent dans mon esprit, mais c’est celle qui me hantera la plus au point parfois de me surprendre à parler toute seule ou de me gratifier de quelques heures d’insomnie (rires) qui deviendra le livre à écrire avant les autres.
Pour écrire, une fois que j’ai élaboré un petit résumé du texte, une sorte de tableau de bord, je vais travailler sur les personnages et c’est une phase qui me prend beaucoup de temps car je crée à chacun de mes personnages une fiche d’identité complète qui trace les grandes lignes de leur place dans le roman, le lien avec les autres personnages, leurs habitudes, leurs descriptions physiques. Je m’attache aussi à leur créer un passé. C’est un détail qui permet de comprendre pourquoi ils sont amenés à agir d’une certaine façon dans le roman. Ça les rend attachants. Après la fabrique des personnages, je choisis le narrateur. Quand je suis certaine de ma voix narrative, je peux commencer l’écriture du roman. D’abord par un premier jet qui me permet de sortir rapidement le texte de mon esprit. Ensuite, j’aborde les différentes phases de réécriture et de relecture. C’est mon moment préféré parce que je travaille la matière du premier jet, je polis les phrases, les mots, je donne de l’envergure aux personnages.
Sur quel support écrivez-vous ?
Charline Effah : J’utilise un cahier pour le travail préliminaire : la fabrique des personnages, le résumé du texte, etc. C’est ensuite un cahier que je garde précieusement durant la phase d’écriture pour rester précise dans l’idée initiale du roman. J’écris sur mon ordinateur.
Avez-vous un rituel ?
Charline Effah : Je n’ai pas de rituel particulier, mais j’ai des endroits dans lesquels j’aime écrire. Mon atelier par exemple, un espace dédié à ma création. C’est un joli petit sanctuaire. J’envisage l’écriture comme un sacerdoce par conséquent, il me faut un espace consacré qu’à elle. Quand je suis dans mon atelier d’écriture, je m’impose une discipline, c’est-à-dire que j’écris pendant 3 heures non-stop. Je prends ensuite une pause pour déjeuner d’une heure et je reprends pour 3 heures non-stop. Dans ces moments, entourée de mes personnages, en immersion complètement dans leur monde, rien d’autre n’existe autour de moi et c’est parfois assez brutal de devoir m’en extraire pour revenir à la vie réelle.
Procédez-vous à de la documentation avant d’entamer l’écriture d’un texte ? Si oui, de quel ordre est-elle ?
Charline Effah : Ça dépend du roman. Des thèmes qui le traversent, par exemple si le roman aborde des faits politiques ou historiques, je lirai des livres, je visionnerai des films, je consulterai des travaux, des articles, des thèses sur le sujet.
Avoir foulé le sol de Bidibidi était pour moi une façon d’acquérir ma légitimité à écrire sur les destins des femmes dans un camp de réfugiés.
Charline Effah
Pour les besoins de votre nouvel ouvrage, qui paraîtra à la rentrée littéraire aux Éditions Emmanuelle Collas, vous vous êtes rendue dans le nord de l’Ouganda. Pourquoi ?
Charline Effah : Lorsque j’ai eu l’idée d’un roman sur les femmes réfugiées, j’ai écrit en 2019 un manuscrit d’une centaine de pages. Puis en me relisant, j’ai eu le sentiment que les personnages n’étaient pas assez habités et qu’il manquait une âme au texte. En même temps, je me posais la question de ma légitimité à parler de ce sujet. C’est ainsi que j’ai décidé de me rendre au Camp de Bidibidi en Ouganda. J’avais besoin de saisir les atmosphères, les couleurs, les odeurs, les émotions dans les regards, et ça a été le cas lors de ma visite dans le camp. Même si les personnes rencontrées étaient plutôt distantes, avoir foulé le sol de Bidibidi était pour moi une façon d’acquérir ma légitimité à écrire sur les destins des femmes dans un camp de réfugiés.
Ce voyage en Afrique est également effectué par Minga, la narratrice du livre qui choisit de se rendre à Bidibidi pour s’informer à la fois sur sa mère et sur son changement de vie à laquelle elle était impréparée. Sillonner les mêmes routes que la narratrice du livre et le mentionner ne risque-t-il pas de créer de la confusion chez le lecteur ? Est-ce une démarche délibérée visant à interroger la relation entre l’auteur et le narrateur ?
Charline Effah : Minga existait déjà avant mon voyage en Ouganda. Et dans le premier manuscrit, elle visitait un camp que j’avais situé dans un espace imaginaire. Sa démarche a donc précédé la mienne. J’y suis allée en repérage, pour capter les lieux et les ambiances du camp. D’ailleurs pour les deux prochains livres à venir après Les femmes de Bidibidi, j’emploierai la même méthode d’aller sur le site qui va camper mon texte
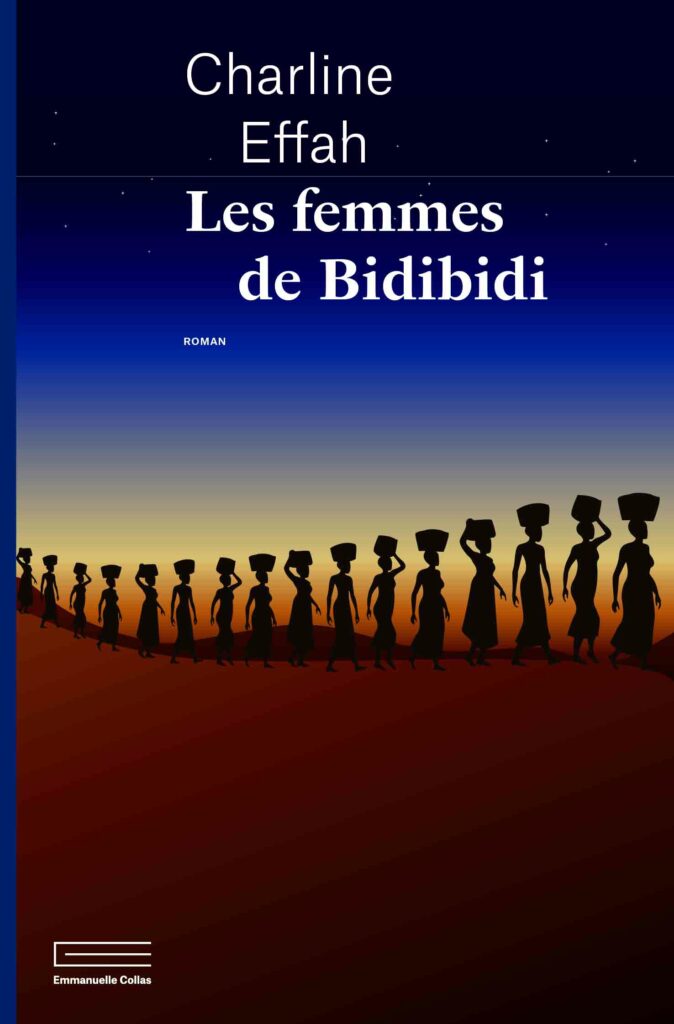
Que ce soit sur la couverture du livre où est apposé le mot « roman » ou sur la page de titre où vous qualifiez celui-ci de fiction, vous semblez attachée à caractériser adéquatement le livre et éviter tout référencement à l’auteur. Pourquoi ?
Charline Effah : Parce qu’il est souvent insupportable quand on cherche toujours à voir des détails de la vie de l’auteur dans son œuvre. Qu’on l’identifie toujours à un personnage et même quand son personnage serait un oiseau, on lui demanderait quand même si ce n’est pas une autobiographie et si l’oiseau ce n’est pas lui (rires). C’est important de lire un texte sans l’associer à la vie de l’auteur.
Quelle est la genèse de ce texte ?
Charline Effah : J’étais tombée sur un article qui traitait de la question des réfugiés dans le monde. L’article parlait en chiffres, en pourcentages, en statistiques et insistait sur le fait que la plupart des personnes vivant comme réfugiées dans le monde étaient des femmes. C’est de cette manière que j’ai voulu m’intéresser à ces femmes en me posant quelques questions à savoir : comment est-ce qu’elles se reconstruisent quand elles ont tout perdu de leur monde d’avant ? Où vont-elles puiser la force pour redéployer leurs ailes brisées et quelle est la matière de leur résilience ? Comment habitent-elles leurs corps de femme dans un contexte pareil, que font-elles de leur féminité, du désir d’enfant, du rapport à la sexualité quand on sait que beaucoup ont été violées durant leur traversée de la frontière entre le Soudan du Sud et l’Ouganda.
Dans quel genre se situe-t-il ?
Charline Effah : C’est un roman.
Dans N’être, il est question des corps cachés, La danse de Pilar revisite les corps instrumentalisés, Les femmes de Bidibidi, c’est l’écriture des corps meurtris par la guerre.
Charline Effah
Outre la galerie de personnages féminins dont vous retracez le parcours difficile, Les femmes de Bidibidi semble être un ouvrage qui invite les femmes, notamment victimes de violences sexuelles ou d’obscurantismes, à se réapproprier leur corps. Ce choix de documenter « la bataille de l’intime » est présent dans plusieurs de vos textes. Quelle en est la raison ?
Charline Effah : Ce choix s’inscrit, en effet, dans un projet littéraire sur le corps des femmes que je construis depuis l’écriture de N’être, roman publié en 2014, La danse de Pilar en 2018 et Les femmes de Bidibidi qui sera en librairie le 25 août 2023. Mon ambition était clairement d’écrire sur le corps féminin en travaillant sur différents angles. Dans N’être, il est question des corps cachés, La danse de Pilar revisite les corps instrumentalisés, Les femmes de Bidibidi, c’est l’écriture des corps meurtris par la guerre. Cet ouvrage, en effet, est un hymne à la réparation des corps à travers leur réappropriation malgré leurs brisures.
Votre livre esquisse aussi une réflexion sur la vénération de figures religieuses dont les traits ne correspondent pas à ceux des populations locales…
Charline Effah : (Rires) C’est un gentil coup de gueule sur les religions importées qui s’imposent en Afrique au détriment de nos spiritualités ancestrales. Mon avis est qu’elles n’apportent rien de probant, mais ces religions sont sollicitées parce que les populations locales ont des quêtes existentielles et le besoin de transcender les tragédies qui traversent leurs vies.
Quels sont les textes et auteurs qui vous ont permis de vous construire intellectuellement et humainement ?
Charline Effah : Les textes de Toni Morrison, Virginia Woolf, Chinua Achebe, Mariama Ba.
Il y a une humanité et un engagement profonds dans leurs romans.
Lisez-vous des auteurs contemporains ?
Charline Effah : J’aime les plumes de Delphine de Vigan, Alain Mabanckou, Théo Ananissoh, Léonora Miano, Ananda Dévi. Ce sont des écrivains ancrés dans le monde dans lequel nous vivons. Et même quand ils revisitent l’histoire, ils nous livrent des récits bouleversants qui tissent des liens entre la grande histoire et les destins individuels.
Je me vois volontiers comme une esthète, une orfèvre, car j’adore les mots, j’aime les travailler, j’aime quand ils résonnent…
Charline Effah
Le travail formel est souvent défini par les auteurs comme un élément indissociable de l’écriture. Quelle place occupe-t-il dans le vôtre ?
Charline Effah : J’aime trouver une résonance entre les thèmes abordés dans un roman et la forme que vont prendre les phrases dans le texte. C’est pourquoi, dans mon roman N’être par exemple, j’avais priorisé les anaphores à souhait. Ces répétitions de mots et de phrases étaient en accord avec l’histoire du personnage qui restait lié à un passé qu’elle rejetait pourtant, comme une histoire qui se répète.
Cette façon d’écrire est très importante dans mon processus de création. Une fois passé le premier jet, je travaille la forme du texte, je fais des essais en usant de différentes voix narratives pour trouver celle qui s’accorde au mieux à l’histoire qui est racontée.
Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?
Charline Effah : Je me vois volontiers comme une esthète, une orfèvre, car j’adore les mots, j’aime les travailler, j’aime quand ils résonnent, j’aime leur rythme, leur musicalité. Mon parcours universitaire m’a donné les outils d’une certaine rigueur et fourni un canevas théorique qui me font envisager l’élaboration d’une œuvre littéraire comme la rencontre entre les structures littéraires et les structures sociales.
Et votre style ?
Charline Effah : Je ne sais pas, mais mon style est connecté à ma musique intérieure. Et si j’écoute cette musique, elle est un mélange de différents genres.
D’autres projets en perspective ?
Charline Effah : Oui. J’ai un autre roman sur le feu. Si Les femmes de Bidibidi clôture le cycle sur le corps féminin, il inaugure en même temps le cycle que j’ai intitulé Suite équatoriale construit autour de trois textes avec lesquels je veux signer mon engagement socio-politique en dénonçant certains maux qui minent l’Afrique noire avec, en tête de file les guerres et l’instabilité politique, les enfants soldats, l’exploitation des richesses du continent et la mauvaise gérance de nos ressources.
