Dans un ouvrage récemment publié aux éditions Le Cavalier Bleu, une cohorte d’auteurs ont mis en avant tout un pan méconnu de la littérature en se basant sur ses plus fidèles représentantes, et les difficultés auxquelles elles furent sujettes dans la publication et dans la diffusion de leurs œuvres en France.
Situations de censure, remaniements des textes, « éreintement critique et social », création de maints fantasmes amarescents autour du lesbianisme, solidarité entre autrices sont entre autres quelques-unes des thématiques abordées dans cet ouvrage d’une richesse savante indéniable, accessible à tous les publics.
Spécialiste de l’œuvre de Renée Vivien et des femmes poètes des XIXe et XXe siècles, Camille Islert est l’une des co-autrices d’Écrire à l’encre violette. Dans deux chapitres passionnants et instructifs, elle dévoile les entraves multifactorielles auxquelles les autrices lesbiennes et bisexuelles ont été confrontées durant la Belle Époque, la construction de certains poncifs (ex : homme manqué) encore utilisés pour les dévaloriser, et l’ingéniosité dont certaines ont su faire preuve pour contourner les clichés et enrichir leurs œuvres et leurs écritures. Entretien avec Camille Islert.
Pour commencer, je vous demande une courte biographie. Quel est votre parcours ?
Camille Islert : J’ai un parcours universitaire assez classique. J’ai suivi un double master en littérature française et en littérature et civilisation latino-américaine, et travaillé respectivement sur Renée Vivien d’un côté, et sur Julio Cortázar puis Alfonsina Storni de l’autre. J’ai poursuivi mon parcours en consacrant ma thèse à l’œuvre de Renée Vivien, dans laquelle j’ai étudié, pour le dire schématiquement, les thèmes de l’intertextualité et de l’influence. Cette thèse m’a amenée à m’intéresser plus largement aux œuvres de femmes à la Belle Époque et aux enjeux des catégories masculin/féminin et de leur dépassement au XIXe siècle. Elle m’a aussi fait m’interroger sur la place des écrits lesbiens au tournant du siècle, et aux résistances spécifiques que leurs autrices rencontraient pour imposer leurs voix dans un paysage littéraire très misogyne.
Vous avez récemment participé à un ouvrage collectif visant à réhabiliter les littératures lesbiennes et ses plus fidèles représentantes en France de 1900 à nos jours. Qu’est-ce qui vous a décidé à prendre part à ce projet ?
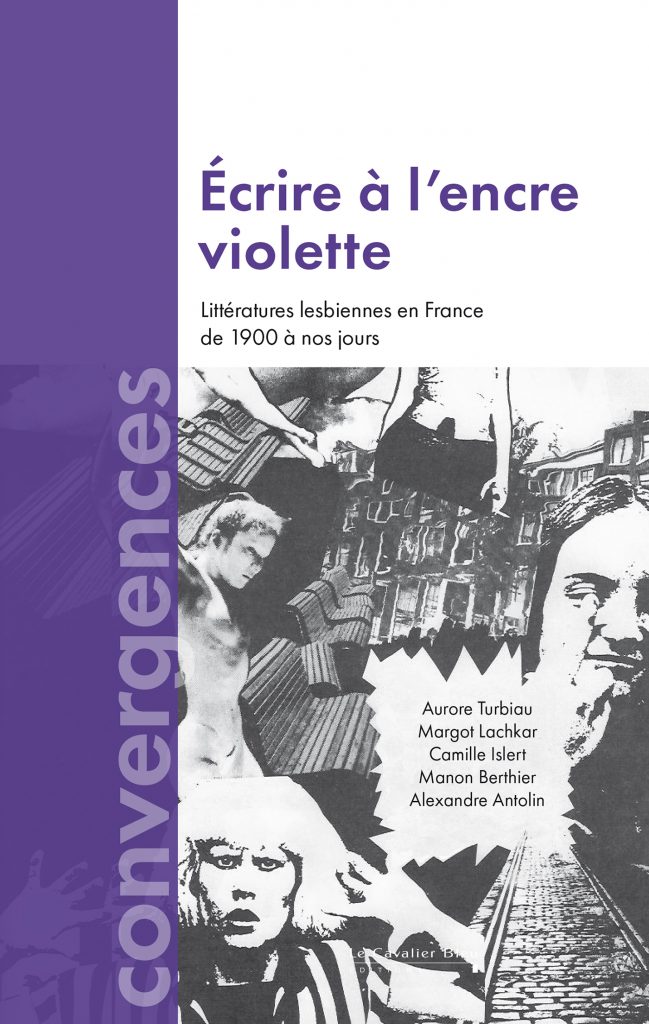
Camille Islert : J’ai été contactée par Aurore Turbiau, qui travaille plus spécifiquement que moi sur ces questions, et qui cherchait des spécialistes d’autres moments et d’autres genres littéraires que ceux sur lesquels elle travaille afin d’établir un panorama des écrits lesbiens publiés en France aux XXe et XXIe siècles. L’ouvrage devait permettre de poser des jalons, de permettre une connaissance à la fois basique et un peu approfondie, et d’ouvrir des pistes de réflexions pour de futurs ouvrages. En fait, de poser un constat central : la littérature lesbienne existe, elle pose des questions particulières sur la littérature générale, elle mérite d’être mieux connue et considérée comme un objet d’étude cohérent. J’ai suivi le projet parce qu’il me semblait essentiel de faire ces constats de base, de rappeler aussi les processus d’invisibilisation à l’œuvre depuis 1900, qui participent à priver les premières concernées de leur histoire littéraire, et donc de leur histoire tout court, mais aussi à faire oublier le rôle que jouent ces œuvres dans l’évolution plus large de la littérature.
Quelles définitions donneriez-vous des littératures lesbiennes ?
Camille Islert : C’est une question compliquée à laquelle nous avons tenté de répondre en introduction plutôt par le négatif, à savoir, qu’est-ce que les littératures lesbiennes ne sont pas. En effet, il est difficile de poser des limites rigides à « une littérature lesbienne », d’où aussi le pluriel du titre : est-ce que c’est le fait que ça parle de femmes qui s’aiment ? non, parce qu’alors il faudrait inclure tout un tas d’écrits sans se soucier de l’auteur ou de l’autrice, sans se soucier non plus du regard fétichisant ou non qui est porté sur le lesbianisme, et inversement il faudrait exclure des œuvres qui ne parlent pas explicitement d’amour entre femmes, lorsque cela n’empêche pas le lesbianisme – qui n’est pas qu’une affaire d’amour entre femmes – d’être présent d’une autre manière. Est-ce que c’est le fait que ce soit écrit par des autrices lesbiennes ou bisexuelles ? Ça ne marche pas non plus, parce que certaines autrices lesbiennes n’ont jamais écrit lesbien ou n’ont jamais voulu être considérées comme telles, parce que ce serait aussi ramener entièrement les productions vers le biographique, et c’est un vieux travers de la critique des œuvres de femmes que de toujours penser les œuvres comme biographiques et personnelles, parce que souvent aussi, on ne connaît pas la vie des autrices, encore moins leurs désirs (parce que la possibilité de vivre son amour pour les femmes au grand jour n’a jamais été entièrement et partout acquise). Est-ce qu’alors c’est le public qui décide ? Est-ce que c’est l’évolution de la réception ? Toutes ces questions, abordées avant nous par plusieurs chercheuses, sont très riches, et nous rappellent qu’il est vain et même contreproductif d’essayer de figer une définition : le but de l’ouvrage n’est pas d’ériger une catégorie restrictive, mais de rassembler des œuvres disparates, différentes, qui ont pour fil conducteur de donner une existence littéraire au lesbianisme. Voilà pourquoi nous avons finalement décidé de garder une définition très large et souple : une littérature qui n’est pas écrite par des hommes cisgenres (et cela pourrait se discuter, il y a des représentations – rares – émises par des hommes qui ne sont pas réifiantes ou fétichisantes, il y a des points de vue dans la catégorie « hommes » qui sont divers) et qui intègre le lesbianisme dans ses enjeux (que ces enjeux soient l’histoire, l’écriture, le point de vue, etc.)
La société de 1900, d’abord, est foncièrement misogyne : la simple possibilité de publier pour les femmes est restreinte, et la crainte de l’éreintement critique et social est grande.
Camille Islert
Sous votre plume, on s’aperçoit que ces « littératures lesbiennes » étaient surtout écrites par des femmes issues de milieux favorisés, voire de nationalités étrangères souvent.
Camille Islert : C’est vrai, et particulièrement pour la période sur laquelle je travaille : l’immense majorité des autrices est issue de milieux favorisés, blanche, parisienne. Cette situation est indéniable : en 1900, pour publier lesbien (j’insiste sur publier, parce que publier n’est pas simplement écrire, et qu’il reste sûrement une grande quantité d’écrits non publiés à exhumer), il faut être riche – à différents degrés, mais tout de même – et blanche. Cela s’explique par plusieurs éléments que je ne peux pas tous rassembler ici. La société de 1900, d’abord, est foncièrement misogyne : la simple possibilité de publier pour les femmes est restreinte, et la crainte de l’éreintement critique et social est grande. Beaucoup d’écrits de femmes à l’époque sont publiés aux frais des autrices, ce qui limite aussi le nombre qui peut se le permettre. Rares sont les femmes indépendantes financièrement, cela veut aussi dire que rares sont les femmes non-mariées, et par conséquent, nombreuses sont celles qui n’ont probablement pas pu écrire de textes lesbiens sans prendre de risques matériels immenses. La société de 1900 est aussi foncièrement raciste, antisémite et xénophobe : on est en plein dans la période de l’orientalisme fin-de-siècle, de la montée du nationalisme, des expositions coloniales, avec une obsession sensible – parfois sous l’angle du fantasme fétichisant, parfois d’une manière ouvertement hostile – pour tout ce qui est étranger. Sous la plume de Charles Maurras, des « étrangères » comme Renée Vivien ou Natalie Barney, blanches toutes deux, anglaise pour l’une, américaine pour l’autre, sont déjà perçues comme « pétries de races différentes » (Le Romantisme féminin, 1906). Leur lesbianisme se voit souvent rapproché du fait qu’elles aient simplement d’« autres mœurs », ou un quelque chose d’ « exotique ». Natalie Barney, paradoxalement, a su utiliser ce statut d’étrangère pour déployer son lesbianisme, elle s’en amuse par exemple dès la publication de son premier recueil lesbien, Quelques portraits-sonnets de femmes : « Rien ne doit vous étonner de moi, je suis Américaine ».
Tout ça pour dire que, oui, le terrain est miné, et les différentes formes de domination, à cette époque comme avant, comme plus tard, s’entrecroisent pour exclure, et ont participé à décourager l’écriture ou à laisser dans l’ombre des textes qui ne nous sont pas – encore ? – parvenus.
En littérature et dans les arts, les couples de femmes sont partout représentés, jusque sur les devantures des bordels… ce qui dit bien la manière dont est alors considéré le lesbianisme : comme un fantasme à destination des hommes.
Camille Islert
En originant votre réflexion sur les travaux de Christophe Prochason, Patrizia Izquierdo et Nicole G. Albert, vous rappelez que la Belle Époque n’était pas un paradis pour les lesbiennes (lieux de sociabilité restreinte, interdiction de spectacles après un baiser entre Colette et Missy sur la scène du Moulin Rouge, création de maints fantasmes amarescents…). Comment comprendre cette assertion ?
Camille Islert : Cette assertion voulait répondre à un certain nombre de fantasmes sur la période de la Belle Époque. Le tournant 1900 correspond à un moment où Paris a une réputation de ville tolérante vis-à-vis de l’homosexualité, par comparaison à Londres notamment. L’expression de « Paris Lesbos » en atteste, de nombreux textes participent à construire cette image d’une ville où « Lesbos se trouve à tous les coins de rue ». En littérature et dans les arts, les couples de femmes sont partout représentés, jusque sur les devantures des bordels… ce qui dit bien la manière dont est alors considéré le lesbianisme : comme un fantasme à destination des hommes. Si les lesbiennes sont omniprésentes, c’est en immense majorité sous le regard masculin, comme une sorte d’idéal de féminité inaccessible. La réalité matérielle est bien différente. Il me semblait important de rappeler que le contexte, contrairement à l’image que le souvenir de la Belle Époque nous lègue, et bien qu’il y ait une petite évolution entre la période décadente et les premières années du XXe, n’était favorable ni aux femmes auteurs, ni aux lesbiennes, et donc défavorables à l’émergence d’œuvres lesbiennes. D’abord parce que la lesbophobie est réelle et croissante, mais aussi parce que l’espace de l’imaginaire (littéraire et plus largement artistique) est saturé par des représentations extérieures, dans lesquelles les lesbiennes ne sont qu’objets fétichisés.
Vous mettez aussi l’accent sur la dépréciation et difficile reconnaissance de cette littérature par les ténors de la profession. « Un éreintement critique » qui poussa de nombreuses autrices à se ranger du côté des stéréotypes forgés par de nombreux artistes masculins…
Camille Islert : Cette réflexion vaut pour les autrices en général : les critiques de la Belle Époque éreintent facilement les œuvres de femmes, et la « femme auteur » est globalement perçue comme un trouble à l’ordre social (C. Planté, La Petite sœur de Balzac). Au fil du XIXe, les discours autour de la production littéraire des femmes se sont durcis, on a naturalisé le fait que les femmes n’étaient pas capables d’originalité, et dès lors que les femmes qui écrivaient étaient contre-nature. Surtout, pour « faire avec » les écrits de femmes qui sont pourtant publiés, et ce en nombre croissant à la fin du siècle, on a érigé une catégorie en dehors de la littérature générale, celle de la littérature féminine, catégorie qu’on a privée d’emblée des qualités dites masculines (originalité, réflexivité) pour la réduire à des qualités compatibles avec le genre féminin (sensibilité, spontanéité, imitation). Dès lors, les femmes qui écrivent ont le choix entre plusieurs voies : se ranger du côté de la catégorie « littérature féminine », en ventant ces qualités ; tenter de faire exception, souvent en dissociant leur féminité matérielle d’une virilité d’écriture qu’elles mettent en avant, ou bien encore faire les deux à la fois, dans un équilibre difficile à tenir.
Ce qu’on observe en 1900, sans figer cette idée qui mérite d’être discutée, c’est que l’émergence d’une littérature lesbienne coïncide aussi avec celle d’une troisième voie, plus subversive, qui consiste à refuser de dévaloriser le fait d’être femme, tout en refusant aussi de se ranger dans les caractéristiques restrictives qu’on a étroitement liées au fait d’être une femme. Bien sûr, ce n’est pas nouveau, et nombreuses sont les autrices qui, au fil des siècles, ont travaillé à démanteler les stéréotypes féminins (je crois qu’il vaut mieux toujours se garder de dire que quelque chose est « pionnier » en littérature). Mais en 1900, pour un temps, cette recherche de subversion et ce travail d’établissement d’un nouvel imaginaire est particulièrement sensible, aussi parce qu’il a quelque chose d’un peu plus collectif.
Renée Vivien garde un bon nombre des mythes et des motifs fondateurs de la poésie de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais les emmène complètement ailleurs en inversant le rapport sujet/objet, et en excluant le regard masculin…
Camille Islert
Justement, certaines autrices, à l’exemple de Renée Vivien, s’emparèrent de ces stéréotypes qu’elles détournèrent pour valoriser leurs productions littéraires et l’amour saphique.
Camille Islert : Renée Vivien est un très bon exemple de ces discours qui émergent. Bien sûr, il n’y a pas que des détournements dans son œuvre, et il serait dommage de n’y voir qu’une écriture en réaction à des imaginaires déjà installés. Elle a su aller rechercher des figures anciennes dans lesquelles se reconnaître, tracer des filiations avec des mythes féminins qui ont en commun la révolte, le refus de plier à l’ordre patriarcal (Lilith, Vashti, les Bacchantes, les Amazones, etc.). Mais en effet, ces figures avaient déjà été mises au cœur de la littérature et des arts par tout le romantisme noir, soit depuis quasiment un siècle : il faut donc aussi jouer avec une tradition, composer avec le déjà là, l’inverser, travailler à la démanteler. Renée Vivien l’a fait d’une manière extrêmement brillante et complexe : en inscrivant son œuvre à la fois dans un long continuum féminin et lesbien (notamment en traduisant puis en intégrant Sappho à son œuvre), mais aussi dans un contexte contemporain, en reprenant, découpant, subvertissant les œuvres masculines décadentes. Elle garde un bon nombre des mythes et des motifs fondateurs de la poésie de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais les emmène complètement ailleurs en inversant le rapport sujet/objet, et en excluant le regard masculin, ce qui lui permet de faire émerger un monde poétique lesbien, et presque, je dirais, de nous montrer son émergence progressive et les résistances qui s’y opposent.
Comment qualifierez-vous votre travail ?
Camille Islert : Je ne saurais pas trop comment qualifier mon travail. Je suis avant tout une littéraire avec une formation littéraire très classique, spécialisée sur le XIXe à partir du master, quand j’ai décidé de consacrer mes travaux à Renée Vivien, sans savoir encore que j’allais continuer à me pencher sur son œuvre jusqu’à la fin de ma thèse. J’ai voulu m’intéresser à des œuvres de femmes parce qu’il me semblait injuste qu’elles ne soient pas davantage considérées, parce qu’il me semblait improbable à moi-même d’en connaître si peu, mais je n’avais pas de formation en études de genre, et j’ai commencé par vouloir traiter ces œuvres avec un œil neutre, comme si elles n’étaient pas écrites pas des femmes, parce que c’est ce qu’on m’avait appris à faire. Évidemment, j’aimerais toujours beaucoup que ce soit possible, mais je crois profondément que ça ne l’est pas, non pas parce qu’il y aurait quelque chose de « féminin » dans l’écriture ou quoi que ce soit d’essentialisant, mais parce que les conditions matérielles de production ne sont pas les mêmes, parce que les imaginaires avec lesquels composer ne sont pas les mêmes, parce que les résistances de l’écriture et du langage ne sont pas les mêmes, parce que la réception n’est pas la même, parce que les conditions d’inscription dans le canon de la littérature ne sont pas les mêmes…Mon travail s’est donc vite heurté à ces questions, et heureusement, parce que je crois qu’il y a dans les études de genre des lunettes qui permettent de revivifier en profondeur les études littéraires, et que je les vois comme un ajout, sans qu’on perde quoi que ce soit de la qualité des analyses.
Voilà, en gros, ce que j’essaie de faire aujourd’hui, j’essaie d’être juste, d’éviter les simplifications et les catégorisations, et de mobiliser au mieux les outils qui apportent et enrichissent l’étude de la littérature, qui reste ma discipline.
En ce moment, je travaille à la publication de ma thèse, justement, ainsi qu’à celle de mon premier roman. Je commence de nouvelles recherches postdoctorales qui auront pour objectifs de mettre en lumière les liens intertextuels entre 8 poètes femmes du début du siècle, toutes nées entre 1875 et 1885, pour essayer de montrer qu’il existe une reconnaissance (même si souvent en sourdine) active et des liens de collaboration entre ces femmes. L’idée serait d’aller contre la tentation de l’époque, celle de rassembler leurs œuvres sous le sceau « féminin », c’est-à-dire en considérant qu’elles auraient des caractéristiques communes involontaires qui correspondent aux attendus d’une catégorie de sexe, et de montrer en revanche qu’il existe entre elles des références et une réflexion communes, et des liens de solidarité actifs.
Pour atteindre une définition plus juste de ce qu’est la littérature, il faut d’abord démanteler notre imaginaire de ce qu’est la littérature, et l’idée qui veut que le classement établi entre ce qui est littéraire ou pas procède d’un regard objectif.
Camille Islert
Qu’est-ce que la littérature ?
Camille Islert : Difficile question, à laquelle beaucoup ont déjà tenté de répondre ! Je ne saurais pas poser des bornes à ce qu’est la littérature. Pour beaucoup de monde, elle demande d’abord quatre choses matérielles – un auteur ou une autrice, un livre, un texte, une publication –, puis elle demande un élément plus symbolique, celui de la reconnaissance, par le public puis une reconnaissance institutionnelle qui va entériner le fait que telle ou telle œuvre est « littéraire » et pas telle ou telle autre. Les critères matériels sont largement remis en question par la multiplication des plateformes de diffusion, par l’importance de la littérature orale, celle des performances, et avec ces deux choses par la possibilité de faire bouger les textes dans le temps (ce n’est pas nouveau, la littérature médiévale nous apprend déjà que ces facteurs matériels sont conjoncturels). Quant à la publication et la reconnaissance institutionnelle, on sait aujourd’hui qu’elle ne suit pas un processus neutre, qu’un nombre immense de textes n’ont pas pu être diffusés, ou ont été enterrés pour des raisons qui n’ont rien à voir avec leur qualité littéraire. Comme beaucoup de spécialistes qui en ont parlé avant moi, je pense que pour atteindre une définition plus juste de ce qu’est la littérature, il faut d’abord démanteler notre imaginaire de ce qu’est la littérature, et l’idée qui veut que le classement établi entre ce qui est littéraire ou pas procède d’un regard objectif.
Vous a-t-elle permis de vous construire intellectuellement et humainement ?
Camille Islert : Je n’ai pas un rapport de sacralisation à la littérature, je crois. Peut-être un rapport un peu cathartique, quand même, parce que les œuvres que j’aime sont souvent violentes, pas forcément dans l’intrigue d’ailleurs mais dans le langage, dans la narration, enfin il y a mille manières de violenter un lecteur, et j’aime bien être un peu secouée par la littérature. Mais j’aime aussi être juste distraite, ou amusée.
Je ne sais pas si la littérature m’a permis de me construire humainement, probablement qu’elle m’a aidée à trouver des représentations, des modèles, des anti-modèles aussi, et parfois (souvent) les deux en même temps. Une des œuvres qui a marqué mon lycée, c’était celle de Bukowski…je me suis construite avec, parce que j’y ai trouvé une forme de violence que je cherchais à ce moment-là, des personnages que je trouvais drôles, qui avaient des pensées basses, un langage qu’on ne nous faisait pas lire en cours, mais en même temps, c’était une construction à double tranchant, parce que les représentations des femmes y sont catastrophiques, que ça a pu m’encourager un temps à détester en être une, et qu’il m’a fallu un temps fou pour me dire : dans son monde, tu n’aurais pas été le héros, mais la femme qu’on agresse au bar. Bref, je bavarde, mais pour dire que je crois que la littérature accompagne nos vies, parfois en ayant un rôle de décoration et c’est très bien comme ça, parfois en ayant un rôle plus fondateur ou catalyseur, mais ce rôle-là, pour moi, se joue autant dans l’édification que dans le repoussoir, et ça aussi, c’est très bien comme ça : elle ouvre des tiroirs.
Outre Renée Vivien, pourriez-vous nous citer quelques textes et auteurs figurant dans votre Panthéon culturel ?
Camille Islert : J’ai un panthéon personnel assez disparate, et qui déborde largement (heureusement) la période sur laquelle je travaille. Difficile de citer des noms ceci dit, parce que hormis le fait que je vais en oublier plein, ces derniers temps, je lis peu pour le plaisir.
Pour les lectures marquantes auxquelles je pense, mais c’est vraiment au fil de ce qui me vient en répondant à l’entretien, en poésie je dirais Joyce Mansour, Robert Desnos parce que ses poèmes d’amour m’ont profondément marquée, Gherasim Luca, Nicanor Parra, Édouard Glissant, Alejandra Pizarnik, Marilyn Hacker…Plus récent, j’aime beaucoup le travail de Rim Battal, celui de Lisette Lombé aussi.
Et puis pour le roman, pareil, impossible de choisir. Dans les lectures qui m’ont vraiment marquée, il y a un peu de tout, dans le désordre, du Perec, Cronopes et Fameux de Cortázar, plus tard Beloved et Home de Toni Morrison, les romans de Richard Brautigan, d’Emmanuel Bove et les nouvelles d’Isaac Bashevis Singer, et puis Violette Leduc…ces dernières années, j’ai été marquée par ma découverte de Grisélidis Réal, et aussi par Mariana Enriquez.
Un dernier mot sur l’apport des autrices lesbiennes à la littérature ?
Camille Islert : Je crois que le mieux pour s’en rendre compte, c’est encore de les lire ! Et d’encourager les militants et les militantes, les associations et les maisons d’éditions qui travaillent à les rendre accessibles.
« Écrire à l’encre violette : Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours » d’Aurore TURBIAU, Margot LACHKAR, Camille ISLERT, Manon BERTHIER, Alexandre ANTOLIN, Le Cavalier Bleu.
