Femme-orchestre de la scène culturelle belge, Myriam Leroy s’attèle depuis plusieurs années à la publication de livres forts et engagés sur l’expérience de la féminité aux XXe et XXIe siècles. Dans Les Yeux rouges, (son dernier roman paru en 2019) elle décrit avec clairvoyance les effets nocifs des « cyber-violences » dans la vie d’une chroniqueuse radio, tristement confrontée à une horde de cybers-harceleurs qui s’érigent en défenseurs de l’Occident face aux « idéologues victimaires » et autres adeptes du « politiquement correct ». Avanies et harcèlement feront alors partie du quotidien de la narratrice qui nous raconte, sans emphase, son existence chambardée par un homme au profil insoupçonnable. Entretien.
Pourquoi écrivez-vous ?
Myriam Leroy : Je crois que j’écris pour être entendue. Car depuis petite, j’ai l’impression qu’on ne m’écoute pas. La seule manière pour moi de m’exprimer sans être interrompu est alors d’écrire. Ça, c’est vraiment le cri originel, le geste primal. Je pense que j’écris aussi parce que j’y parviens et prends du plaisir. Donc, pour moi, c’est vraiment la manière la plus naturelle de dire les choses et pas toujours au premier degré. Mais globalement, j’écris pour qu’on m’écoute.
À l’exemple d’Ariane et Les Yeux rouges, votre dernière publication destinée au théâtre s’emparait de deux sujets sociétaux majeurs : la filiation et la question des origines. Votre littérature est-elle un portrait des sociétés actuelles avec leurs énigmes et contradictions ?
Myriam Leroy : Si je devais définir ma littérature, je dirais que c’est de mettre la focale sur ce qui est considéré comme étant infra-ordinaire ou tabou. J’essaye de parler de choses dont on ne parle pas. Que ce soit la problématique des enfants de donneurs qui est entourée d’un impressionnant tabou ou le harcèlement des femmes et la misogynie. Toutes les choses qu’on tait, moi, il faut que je les dise. Car l’écriture me permet cela.
Justement, vos deux premiers livres racontent une histoire d’amitié adolescente et une situation de « cyberviolences » à laquelle est sujette une jeune femme...
Myriam Leroy : C’est la misogynie et la haine des femmes qui relient ces deux livres. De manière très explicite dans Les yeux rouges, on voit que c’est une femme qui est harcelée parce qu’elle est une femme et réduite à ses orifices. Dans Ariane, c’est moins frontal puisque le livre parle de ce qu’est une vie de jeune fille. Des attentes de la société sur les jeunes filles. De l’obligation de séduction qui leur est attribuée et de ce qui se passe vraiment derrière ça. Je voulais montrer ce qu’il y avait vraiment derrière les êtres ultras sexués et doués de séduction que la société essaie de faire des adolescentes et des enfants alors que ce sont des individus comme les autres. Avec leurs médiocrités, leurs méchancetés, leurs manières familières de s’exprimer. J’ai aussi voulu montrer la vérité des corps. Montrer des jeunes filles qui transpirent, qui sentent mauvais, qui ont des boutons et qui sont parfois méchantes. Tout ce qu’on ne montre pas généralement dans les littératures qui abordent l’adolescence où il y a une norme qui fait qu’elles sont toujours montrées dans le camp des êtres mystérieux, gracieux, auxquels les autres ne comprennent rien et qu’elles font tourner en bourrique. Donc, il y avait une volonté de montrer authentiquement l’expérience sociale de la féminité. Dans les années 1990, à travers Ariane et puis celle d’aujourd’hui avec Les yeux rouges où dès qu’on est une femme et qu’on apparaît dans l’espace public, on est d’office insultée, harcelée, menacée avec des termes à caractère sexiste et sexuel. Voilà ce qui rejoint les deux livres.
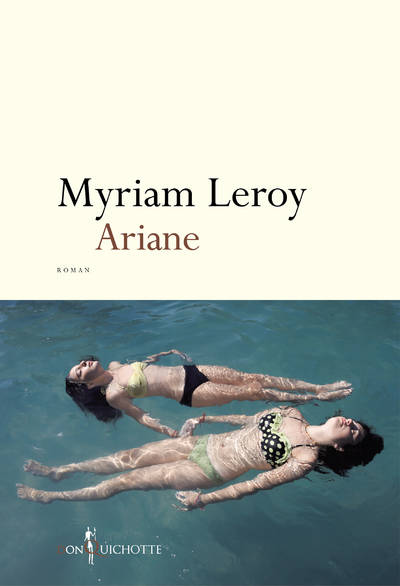
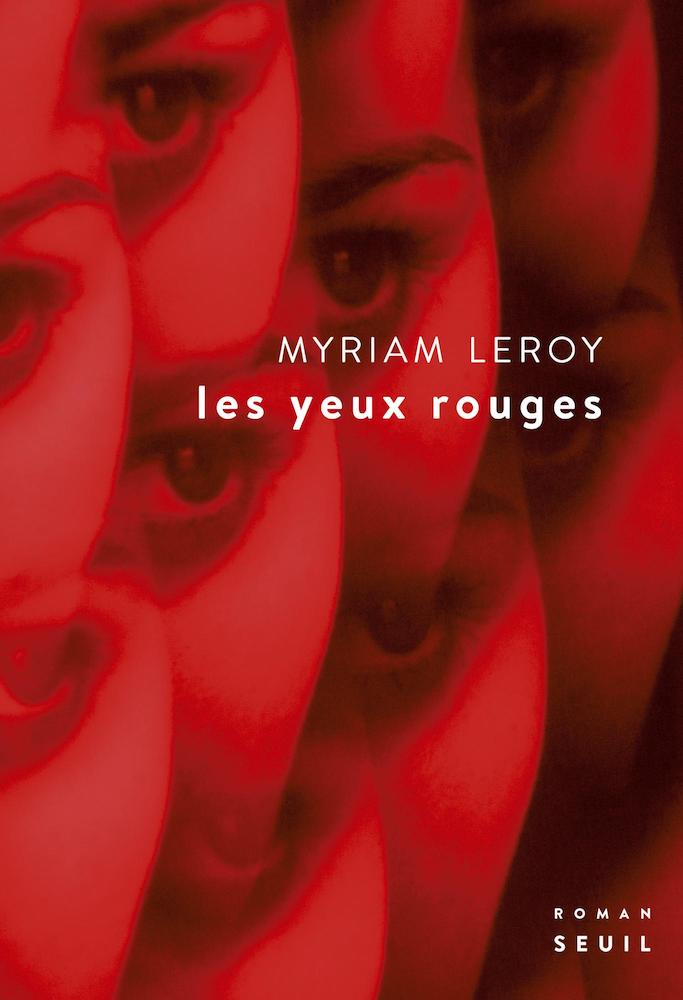
Pourquoi avoir raconter ces récits à la première personne ?
Myriam Leroy : Pour Ariane, il m’a semblé juste de le raconter à la première personne « je », pour le mettre à hauteur d’adolescent utilisant une langue un peu hybride. Et puis c’est une adulte qui se souvient de son adolescence. Évidemment, quand on se remémore les situations vécues, on redevient la personne qu’on était à ce moment-là. Donc, c’est une langue adulte mais infusée d’un peu d’adolescence, car ce n’est pas tout à fait la langue qu’on emploierait avec des gens de trente-cinq ans, ni de quarante ans. Il me semblait que la première personne du singulier permettait cela. Ça a été très long de mettre au point cet angle qui me permettait de relater la réalité que je voulais raconter de la manière la plus juste possible. C’est donc de l’ordre de l’instinct, du ressenti et de l’intuition.
Que ce soit dans Ariane où le style âpre est souvent mêlé à une écriture ironique et épistolaire, ou dans Les Yeux rouges contenant un langage utilisé sur internet, votre littérature aime se détacher des préceptes dominants. Quelle place occupe la forme dans votre travail littéraire ?
Myriam Leroy : C’est la place la plus importante. Parce que lorsque je ne l’ai pas trouvée, je ne peux pas écrire. Chaque sujet appelle sa forme. Dans Les yeux rouges, j’ai mis plusieurs années avant de trouver le style narratif et la langue. C’est-à-dire une langue assez intéressante pour être écrite et lue par un lecteur, mais qui comporte toute la banalité et la médiocrité des échanges quotidiens sur Internet. Une langue qui comporte aussi une part de vulgarités, et d’oppression. J’ai cherché pendant des années différentes manières de raconter cette histoire. C’est en relisant un passage du livre Ariane où la narratrice revient en classe après avoir embrassé son premier copain et qu’elle était pour cela méprisée par Ariane, dans un paragraphe écrit en style indirect libre que j’ai trouvé la forme narrative pour Les yeux rouges. Je voulais qu’on sente le mépris et qu’on sente à quel point la narratrice était le jouet de la personne dont elle relate les paroles. Mais clairement, sans la forme, je m’égare. J’essaye dans tous les sens et ça peut prendre très longtemps.
Parmi les auteurs que vous aimez, vous citez souvent Virginie Despentes et Emmanuel Carrère. De quelle manière, ces deux écrivains influencent-ils votre littérature ?
Myriam Leroy : Emmanuel Carrère est vraiment un auteur qui me donne envie d’écrire quand je le lis. Car je vois à quel point, il peut puiser dans les choses anodines qu’il y a autour de lui pour en faire quelque chose d’unique. C’est très étrange ce qu’il parvient à faire avec si peu de choses. Il y a un livre (Emmanuel Carrère : faire effraction dans le réel) qui essaye de débusquer les mécanismes de son œuvre, ce qui est très difficile. Dans ce livre collectif, il y a un auteur qui s’interrogeait sur le fait qu’il y avait des notes dans tous les sens, mais qui donnait quelque chose au bout du compte, et faisait une analogie avec une symphonie. Emmanuel Carrère est donc une influence parce qu’il me stimule intellectuellement. Virginie Despentes, elle, me bouscule par son écriture débarrassée de toute politesse. Elle ne tourne pas autour du pot. Son écriture est très belle, très musicale et infusée d’une poésie qui ne ressemble qu’à elle. Elle m’influence pour cela. Mais au-delà du fait qu’elle m’influence littérairement, c’est quelqu’un que j’ai adoré écouter en interview parce que je trouve que ce qu’elle dit est juste dans notre monde gouverné par la langue de bois, par les éléments de langage, par la propagande à moitié déguisée. Il y a quelque chose de très sincère dans ce qu’elle dit sur le monde.
C’est comme avoir une amie qu’on ne connaît pas. Quelqu’un qui nous veut du bien mais qui ne sait pas qu’on existe. Bien plus qu’intellectuellement, c’est humainement que Virginie Despentes est importante dans mon parcours.
Elle a été accueillie avec du goudron et des plumes parce que les faiseurs de tendance, les jurés, les tenants du bon goût estimaient que ces histoires de bonne femme et du monde ouvrier n’avaient rien à faire en littératures.
Myriam Leroy
Qu’en est-il d’Annie Ernaux ?
Myriam Leroy : Quand j’ai lu pour la première fois Annie Ernaux, il s’est passé quelque chose en moi. Je ne cessais de lever mes yeux du livre pour dire à quel point c’était génial à la personne qui était à côté de moi. Lorsqu’elle me demandait ce qu’il y avait de génial dans le livre, j’avais beaucoup de mal à l’expliquer. On dit souvent que c’est une écriture blanche alors qu’elle n’écrit pas tous ses livres dans le même style. Il y a quelque chose dans ses livres qui évoque un « mode d’emploi » du monde passé ou « un mode d’emploi » du monde présent. Elle a une écriture dépouillée de toute fioriture inutile, de tout ce qui fait perdre du temps, que je trouve géniale. Bien sûr, il y a tous les sujets qu’elle aborde avec rigueur aussi. La manière dont elle a été traitée par le monde littéraire est quelque chose qu’on a tendance à oublier. Elle a été accueillie avec du goudron et des plumes parce que les faiseurs de tendance, les jurés, les tenants du bon goût estimaient que ses histoires de bonne femme et du monde ouvrier n’avaient rien à faire en littératures. Mais, elle a creusé son sillon et aujourd’hui tout le monde sort de la pièce à reculons en présence d’Annie Ernaux. Un jour ou l’autre, elle aura le prix Nobel, ça me parait certain. Elle a donc une forme de courage aussi, à ne pas se laisser intimider, à continuer malgré la manière dont ses œuvres ont été traités donc elle a écrit l’histoire. Je suis admirative de son œuvre pour cela.
Le cinéma a un rôle important dans vos textes, grâce notamment à l’évocation des films pour illustrer certains faits…
Myriam Leroy : Je ne pense pas qu’Ariane soit un livre très cinématographique même si chaque scène comporte une tension que j’ai appris à aménager grâce à des séminaires d’écriture audiovisuelle suivis dans le cadre d’autres projets. L’évocation des films et des acteurs est là simplement pour montrer à quel point nous sommes tous infusés de pop culture. Je parle beaucoup de musiques aussi et des tubes des années 1990 pour montrer qu’on a un référentiel commun. Un référentiel en l’occurrence sexiste. C’est là que le cinéma apparaît. Mais s’il y a bien un film qui m’a influencé dans l’écriture d’Ariane, c’est bien Kids de Larry Clark, notamment pour ce qu’il montre de ce que l’adolescence peut avoir de dégueulasse, de triste, de violent. C’est un film que j’ai vu à l’âge qu’a Ariane dans le livre et qui ne m’a jamais lâché.
Qu’est-ce qui vous plait dans le cinéma que vous ne trouvez pas en littérature ?

Myriam Leroy : Ce que j’aime dans le cinéma, c’est la force de frappe auprès du grand public. C’est la possibilité d’être diffusé à la télévision à une heure de grande écoute et d’être vu par le plus grand nombre. Donc que le message fonctionne auprès du grand public. Mais en général, ce que le cinéma permet et pas toujours la littérature, c’est un enchantement. Je me souviens des états dans lesquels le cinéma a pu me plonger. Des états d’enchantement venus d’un monde créé à partir de rien et qui devient réel par la puissance et la force évocatrice de l’image. Des corps qui se meuvent à l’intérieur des scènes. C’est pour moi la grande beauté du cinéma. Il m’intéresse quand il est le lieu d’inventions d’univers nouveaux. La littérature, quant à elle, m’intéresse pour le décryptage de l’univers qui existe, dans lequel on est.
Quid du théâtre ?
Myriam Leroy : Ce que j’adore dans le théâtre en tant que spectatrice, c’est l’expérience collective au même moment. C’est applaudir un travail de longue haleine mené par une équipe. C’est la possibilité de faire jaillir des images là où il n’y en a pas et où il n’y a qu’un décor constitué d’un bout de bois dont on accepte la transformation en palais, armure ou dragon. Il y a quelque chose de magique pour moi dans le théâtre en tant que spectatrice. En tant qu’auteure de pièces de théâtre, ce qui me plaît, c’est le travail d’équipe que j’ai, qu’on retrouve un peu dans le documentaire même s’il y a quelque chose de plus rapide, de plus inégal, de plus collectif dans le théâtre. Il y a aussi une extrême plasticité. Le fait que d’un jour à un autre, tout soit différent. C’est évidemment un énorme plaisir d’écrire des pièces de théâtre, puis de voir des gens heureux en sortant de la salle.
Des projets littéraires en perspective ?
Myriam Leroy : Je travaille depuis un an sur mon troisième roman qui raconte l’histoire d’une femme décapitée durant la Seconde Guerre mondiale et enterrée dans mon quartier. C’est compliqué à écrire d’autant plus que ce n’est pas une période de l’histoire que je connais bien, ni à laquelle je me suis beaucoup intéressée à l’école. Alors je mène de manière un peu candide et profane, une enquête sur cette femme. C’est passionnant parce que ça parle de sexisme et de résistance : un concept complètement dévoyé de nos jours. Ça parle aussi d’amour et d’un monde qui ressemble largement au nôtre avec des prédicateurs de haine qui font petit à petit des trous dans le discours public et dont les vociférations sont de plus en plus considérées comme étant normales et digne d’être entendues et diffusées. Il y a donc quelque chose qui résonne très fort avec notre époque même si ça se passe en 1941. C’est probablement mon projet le plus excitant parce que j’apprends plein de choses. C’est un peu mon université, ce roman.
Les livres qui me plaisent en tant que lectrice, ce sont les livres qui coûtent à leurs auteurs et dont ils sont les seuls au monde à pouvoir les écrire, car il y a quelque chose d’urgent, de brûlant.
Myriam Leroy
Que représente pour vous, la littérature ?
Myriam Leroy : Je crois que je n’aime pas le mot « littérature ». Je ne comprends pas très bien ce qu’il veut dire. Je crois qu’il est souvent utilisé pour donner des définitions assez définitives, et des citations par ci et là. Pour moi, la littérature, c’est simplement une forme au service d’un écrit. Ça peut être capable de tout et son contraire. Ça peut être capable d’inciter à la haine comme d’enchanter. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a mille sortes de littératures et qu’il est impossible de donner une définition claire. Les livres qui me plaisent en tant que lectrice, ce sont les livres qui coûtent à leurs auteurs et dont ils sont les seuls au monde à pouvoir les écrire, car il y a quelque chose d’urgent, de brûlant. Les livres qui donnent toutes les clés ou sont juste un passe-temps ne m’impressionnent pas tellement. Mais si je dois en dire un mot, une définition un peu pédante, je dirais que la littérature, c’est quand ça fait mal.
